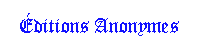 |
TEXTICULES
Les Texticules sont un ensemble de textes écrits par le Capitaine Nemo, alias Xavier
Lucarno, alias Christian Bartolucci. Ces textes se voulaient une critique de la
critique de la théorie de Debord par Jean-Pierre Voyer. Devant laccumulation
de « propos absurdes » que lui prêtait M. Bartolucci, M. Voyer
sest finalement résolu à lui répondre dans son fameux texte La peste soit
des malcomprenants. La réponse de M.
Voyer nayant pas eu lheur de plaire à notre fougueux polémiste à deux balles,
celui-ci continue de plus belle.
Les Texticules postés à lorigine sur le feu Debordoff entre 1997 et 2001 avaient été assemblés et republiés par lintermédiaire
de M. Franck Einstein, webmaster du feu Debordel. Or nous constatons que cet assemblage a lui-même disparu du Web,
privant les lecteurs des tenants et des aboutissants de La peste soit des
malcomprenants. Nécoutant que leur
courage, et, munies dune corde et dun piolet comme Gaston Lagaffe, les Éditions
Anonymes se sont enfoncées dans les profondeurs de leurs archives doù elles ont
réussi à extraire, des
décombres
encore fumants sur lesquels flottaient
deux
misérables étendards, ces textes que nous remettons désormais à la disposition du public.

Potlatch à Jean-Pierre
Voyer
[Ce texte a été adressé à Jean-Pierre Voyer en
1993, par lintermédiaire de son éditeur. Cétait une tentative de prise de
contact qui est restée sans réponse. Cétait donc un Potlatch sans
contrepartie. Lorsque jai publié, en juillet 2001, Mérite et Limite du
système de Voyer, je terminai par : « pour solde de tout
compte » : ce texte fait partie du solde.]
« Le
travail théorique, jen suis chaque jour plus convaincu, réussit mieux dans le
monde que le travail pratique : dès quune révolution se produit dans le
royaume de la représentation, la réalité effective ne tient plus en place. »
Hegel
à Niethammer, le 28 octobre 1808.
Le
siècle qui sachève aurait, dit-on, linsigne privilège de voir la fin des
idéologies qui ne sont que les formes organisées du mensonge. La vérité, qui
parle dor, aurait vaincu, finalement. À ceux qui feraient remarquer que la
victoire est amère, il sera répondu : cest là sa marque. LApocalypse
vient avant le Royaume Millénaire, les Temps sont proches ; nous serons
bientôt rendus.
Léconomie
marchande a vaincu mondialement ; la Science économique a terrassé la
Bête. Et il y aurait encore des tarés pour mettre en doute lexistence si
manifestement avérée de lÉconomie ? Quoi ! Certains « mauvais
esprits » pousseraient lexcès jusquà nier la Science même. Quelle
impudence ! Quel scandale ! Malheur à celui par qui le scandale
arrive.
Ainsi,
lÉconomie qui na jamais été, quoi quon dise, une science [au sens de science
« dure » ; il y a bien une mathématique de léconomie :
mais qui sy intéresse ?], est-elle devenue cette croyance universelle.
Quand toutes les églises seffondraient, elle était seule à rester debout au
milieu des décombres et des ordures : alors les peuples incrédules se sont
convertis en masse ; cest quils étaient forcés et il ny avait plus le
choix.
On
ne combat pas une croyance avec les arguments de la raison : on croit
parce que cest absurde. Les milliers de pages du Capital où Marx
attaque sans désemparer lÉconomie avec les armes de la raison marchande bien
comprise, nont servi au bout du compte, quà renforcer le Dogme : le
discours était excellent, mais la méthode sest révélée mauvaise. Trêve, donc,
darguties scolastiques ; place au Casse-Dogme : « lÉconomie
nexiste pas » !
Foutre !
Voilà ce qui sappelle une critique radicale. Le retour de la philosophie à la
faucille et au marteau, en quelque sorte. Ce que dautres avaient vainement
tenté de dénouer a été tranché
1 ;
alors, martelons : « lÉconomie nexiste pas » ; il
ny a pas de « réalité » économique ; lÉconomie est une
idéologie. Ça finira bien par rentrer dans quelques têtes, nom de Dieu !
Pourtant,
nous sommes bien forcés, quand même, dadmettre que tout continue. LÉconomie
existe comme idéologie, comme mensonge sur le monde : cest une calomnie
qui doit cesser.
La
bourgeoisie marchande, comme toute classe qui arrive au pouvoir, avait besoin
la victoire sur le terrain lui étant acquise dune légitimation théorique,
dune Science qui létablisse dans son droit, qui montre quelle nétait
pas née dhier, mais quelle plongeait des racines profondes dans le terreau de
lHistoire parce que le pouvoir avait cessé dêtre de droit divin ; et
que le ciel nenvoyait plus de mandat. Cest ainsi que lhistoriographie
bourgeoise ira rechercher une économie primitive qui, sinstruisant avec
le temps, aurait trouvé une manière daboutissement avec laccession au pouvoir
de la bourgeoisie, la classe de lÉconomie. Et cest ainsi que parallèlement,
Marx et Engels trouveront plutôt, quant à eux, un communisme primitif
dont lapothéose serait à venir pour peu que le Prolétariat renverse la
bourgeoisie usurpatrice et exploiteuse et sempare de lÉconomie qui lui
reviendrait de droit, en tant que classe laborieuse créatrice de la valeur.
Cest une belle Histoire quon a beaucoup racontée aux enfants du siècle, pour
les endormir. Il sagit maintenant de les réveiller.
La
réalité est quelque peu différente. LÉconomie nest pas au monde ; il ny
a pas de « réalité » économique. Ce qui agit dans le monde,
cest la marchandise ; ou plus exactement, la marchandise est le vecteur
de ce qui agit dans le monde. LÉconomie est une théorie de la
marchandise doublée dune conjuration destinée à se concilier les
bonnes grâces de la redoutable puissance qui lhabite. Comme théorie, elle a
pour objet de comprendre comment ce qui agit dans la marchandise agit,
de manière à sen servir au mieux de ses intérêts ; elle a également pour
fonction de simposer dans le monde, et den imposer au pauvre
monde en lui en mettant plein la vue.
Comme
conjuration, elle se sert de larsenal impressionnant de formules abstruses
mises au point dans la théorie pour essayer de modérer les excès de la force
démoniaque qui anime la marchandise ; sans grand succès dailleurs, de
ce côté-là, tant il est vrai que la marchandise est la chose anti-économique
par excellence. Il est impossible de la raisonner : elle nen fait quà sa
tête, comme un simple coup dil jeté sur le tableau du monde de lÉconomie
devrait suffire à en convaincre quiconque.
Ce
qui agit dans la marchandise, cest largent : cest lui cet
« esprit dun monde sans esprit ». (Marx a, par ailleurs,
parfaitement reconnu le caractère fétiche de la marchandise.) La
marchandise est possédée par la valeur. Elle ne pense quà
largent ; largent est le démon qui agite la marchandise, qui jamais ne
la laisse en repos, qui loblige à une circulation incessante que rien ni
personne ne doit venir entraver. « Laissez-faire ; laissez-passer » :
cest une question de vie ou de mort ; les marchands le savent bien qui se
sont voués à la marchandise en échange du pouvoir sur ce monde. Cest ainsi que
lhistoire a progressé par son mauvais côté.
Contrairement
à une idée trop bien reçue, ce nest pas le travail qui crée la valeur comme
ne lignorent pas les commerçants depuis le temps quils se consacrent à la
circulation des marchandises et quils senrichissent. Le boutiquier sait
dexpérience quune marchandise qui ne se vend pas na aucune valeur ; et
de mémoire de prolétaire, on na jamais vu personne senrichir par son travail.
Ce sont les économistes bourgeois qui découvrirent opportunément que le travail
était le créateur de la valeur ; et Marx voulut bien les croire. Cest
ainsi quil en vint nolens volens à apporter la précieuse caution de
la critique révolutionnaire à la pseudo-Science économique. Pour Marx, comme
pour les économistes bourgeois, le travail est essentiel : essence
et confirmation de lessence de lhomme. Mais, si le travail est essentiel,
cest seulement à celui qui fait travailler les autres ; et il nest
devenu essentiel à la bourgeoisie marchande que lorsquelle a dû cétait la
rançon du succès soccuper du procès de circulation des marchandises dans son
ensemble : lorsquelle est devenue un entrepreneur capitaliste. Mais
cétait déjà, là, la fin de lhistoire. Revenons.
Le
secret de la réussite, cest au début quil faut le chercher, dans la pratique
même de lactivité marchande : le trafic. Ce que les
marchands ont appris en trafiquant, cest que la communication est
essentielle ; cest elle qui fait la valeur ; celui qui est
maître de la communication, est le maître du monde. Cest parce que la
marchandise contient le principe quelle a pu faire tomber toutes les murailles
de Chine comme sont tombés les murs de Jéricho ; et que rien na réussi à
entraver durablement la mise en place de son réseau de communication
planétaire. Voilà le secret de la réussite de la bourgeoisie
marchande : elle a conquis le monde parce que, par sa pratique, elle avait
à faire avec le principe, avec ce qui agit véritablement ;
parce quen se mettant au service de la communication marchande, elle en a
acquis une certaine « maîtrise ». Tout le reste nest que
littérature.
Ainsi,
lhistoire est bien lhistoire de la communication, mais de la
communication marchande ; une histoire où ce sont les marchandises qui
séchangent au moyen des hommes : une histoire inhumaine ; lhistoire
de laliénation de la communication. Cest lhistoire « pleine de
bruit et de fureur » de la société marchande, qui domine aujourdhui
sans partage. Cest un drame : il fallait que lEsprit fût expulsé du
monde pour que la pensée séparée lintellect régnât en maître et
refît le monde à son image. Cest à partir de là que la société de la
marchandise a pu faire les progrès spectaculaires que lon a vus et
développer une instrumentation de plus en plus sophistiquée de la domination
dont laboutissement est le bouclage planétaire de son réseau de communication
et linformatisation concomitante de la pensée séparée.
On
a cru longtemps sêtre débarrassé de cet Esprit encombrant ; mais qui
croyait lavoir chassé par la fenêtre, sexposait à le voir revenir par la
petite porte. LEsprit nous avait envoyé son fils ; il a été mis à
mort : nous nétions pas raisonnables. En partant, il nous a laissé sa
croix ; « la rose de la Raison sur la croix du présent »
(in memoriam) : attention aux épines ! En fait, lEsprit
nétait jamais vraiment sorti du monde auquel il est immanent. Pendant
le Grand Siècle, qui voyait sinstaller lexplication mécaniste de
lhomme et du monde, promise à un si bel avenir et pour laquelle lEsprit était
une hypothèse superflue, les alchimistes, avec plus de conséquence, lont
recherché dans la matière dont ils voulaient le libérer, redimant
celle-ci du même coup ; et cest là, précisément, que nos modernes
physiciens semblent ly avoir retrouvé. Notre monde était habité et nous
ne voulions pas le croire : nous allons y être contraints à présent.
Avec
la fin de la fausse opposition (spectaculaire) entre le capitalisme marchand et
le communisme, nous pénétrons dans un monde unifié où lAdversaire ne pourra
plus être commodément rejeté dans une extériorité menaçante, face à laquelle
tout serait par avance justifié ; il va falloir se résoudre à le réintégrer
à sa place. LEsprit quon avait voulu bannir du monde y est revenu sous les
traits du Prince de la Division. Celui à qui lon a fait du tort, réclame justice ;
et il est décidé à mettre le monde à feu et à sang tant quil naura pas obtenu
réparation. Le jugement de Dieu est commencé, nen déplaise au
matérialisme vulgaire qui voudrait encore faire illusion ici et là après tout
ce quon a pu voir. Le Grand Jeu continue. Il nous appartient de ne pas
démériter de lEsprit dont nous sommes responsables.
Janvier
1993.
1.
Vous en avez rêvé ; Jean-Pierre Voyer la fait.
SALUT LARTISTE !
TANT PIS SI JE ME TROMPE !
1. À propos de
la réponse à Rideau ! de M.-É. Nabe.
Monsieur,
Longtemps
vous avez utilisé le concept de spectacle avec une telle pertinence quil est
difficile de croire que vous ne saviez pas de quoi vous parliez. Aujourdhui
vous affirmez quil ny a pas une idée dans le livre de Debord. Vous laissez
entendre quaprès de longues recherches vous êtes arrivé à la conclusion que le
mot de : spectacle, qui était obscur pour vous dès le début sest
révélé être, in fine, totalement vide de sens. Il serait plus juste de
dire : il y avait de lidée dans La Société du spectacle, mais il
ny en a plus. Et il faudrait alors expliquer cette étrange disparition. On
sait la grande volatilité des idées : livresse passée, il ne reste que le
flacon vide et la gueule de bois. Le fait est que vous ne voulez tout
simplement plus en trouver (enfin, quand je dis simplement : ça
nest peut-être pas si simple). Vous avez vos raisons qui se doivent
dêtre bonnes. Mais si vous tenez vraiment à prouver la nullité du concept de
spectacle, il faudrait que vous soyez pour le moins aussi convaincant que vous
saviez lêtre lorsque vous lemployiez avec toute la force de conviction de
celui qui est lui-même convaincu. Évidemment, vous pouviez alors vous
tromper. Ou est-ce à présent que vous faites erreur ? « Pourquoi
croirai-je avoir plus desprit aujourdhui que lorsque je pris ce parti ? »
À moins que tout compte fait cela ne soit quun jeu comme
Ripley vous vous amusez. Quoi quil en soit, vous y revenez, après tout ce long
temps. On revient toujours à ses premières amours ; comme lassassin
revient fatalement sur le lieu de son crime.
Donc,
vous ne voulez plus de la société du spectacle que vous retournez
facilement (cest une vielle connaissance) en spectacle de la société ; et
vous donnez de lopération lexplication suivante : « le
spectacle de la société est un effet secondaire de lisolement des esclaves »
exclus de la véritable communauté (largent, Marx dixit), privés de la
communication par le commerce, ils ne peuvent être que des spectateurs et non
sa cause ; et par conséquent, il est impropre de nommer une telle
société : du spectacle, il faut dire : de lisolement, puisque le
spectacle ne cause pas lisolement mais que celui-ci est la condition sine
qua non de celui-là. Admettons. Quoique Debord ne dise pas que le spectacle
est la cause de lisolement ; il dit même le contraire : « Le
spectacle réunit le séparé, mais il le réunit en tant que séparé. »
cest donc quil létait avant. Il précise aussi que le spectacle apparaît
avec la marchandise abondante et quil est la forme que prend le rapport social
dans une société totalement dominée par la marchandise : cest le
fameux « spectaculaire-marchand » ; ou faut-il
dire : le marchand-spectaculaire, puisque le spectacle est second, effet
et non cause de la marchandise. Ce qui veut dire, si je comprends bien, que la
société où domine la marchandise (unifiée par le commerce, si vous
préférez) est un spectacle pour les esclaves isolés : le spectacle ne fait
que rassembler la foule des esclaves solitaires. Aussi Debord ajoute-t-il quil
« se présente à la fois comme la société même, comme une partie de la
société, et comme instrument dunification. » La chose est, on
le voit, compliquée. Examinons donc de plus près (pas trop, de crainte
que lobjet ne nous échappe) ce curieux concept dont la nature semble si
paradoxale.
À
la racine du spectacle Debord place la « non-intervention » ;
et il le définit alors comme une communication unilatérale, un monologue. Par
exemple : quelquun qui parle devant dautres qui se taisent. Dans la
société où domine la marchandise, cest évidemment la marchandise qui a la
parole et qui représente la communication face aux spectateurs qui en
sont privés : la communication sest donc bien « éloignée
[pour eux] dans une représentation ». Par conséquent la société de
la marchandise est bien la société du spectacle de la communication ;
cest-à-dire : la société du spectacle de la société. Ce qui nimplique
nullement que le spectacle soit la cause de léloignement de la
communication ; il lui suffit doccuper le terrain comme vous le
notez avec raison des médias qui ne sont que linstrumentation du spectacle
dont vous ne voulez plus.
« Lépaisse
stupidité marxiste » de Debord la certainement empêché de dépasser la
vision bornée de léconomie et de reconnaître la communication
comme principe
1 de
la société ; il nen réussit pas moins, en bon marxien, à
identifier laliénation de la communication comme spectacle (dans le spectacle,
cest sa propre essence séparée qui fait face au spectateur doù le
grand effet du spectacle : la fascination : cest bien « lui
qui a fait tout ça et il est content ») ; et à élaborer « la
première théorie qui depuis Marx se soucie dêtre une théorie de
laliénation. » Cest vous qui le dites cétait en 1971, il est
vrai : cela ne nous rajeunit pas. Aujourdhui vous voulez régler son
compte au spectacle. Dans lalternative que vous posez : ou bien la notion
de spectacle est vide de sens ;ou bien elle signifie les médias : ce
qui est sans intérêt, vous ne lui laissez aucune chance. Ce nest plus une
alternative, cest une exécution sommaire ; en tout cas,
cest une fausse alternative mais un véritable guet-apens : vous
en défendez chacun des deux termes, alors que le choix de lun devrait
logiquement laisser lautre libre dans laquelle vous lenfermez pour mieux la
nettoyer ; vous faites un sale boulot : on comprend que vous
le fassiez salement.
Le
théoricien Debord
2
nest certes pas exempt de tout reproche comme il le prétend. Ainsi donne-t-il,
entre autres, la définition suivante du spectacle : « un rapport
social entre des personnes médiatisé par des images » ;
cest-à-dire par les représentations dominantes (qui sont celles de la
marchandise). Mais il ne sagit quapparemment dun rapport aliéné entre
des personnes ; en réalité laliénation consiste précisément en ce
ceci : que ce rapport a lieu exclusivement entre des marchandises au
moyen de personnes. Ou, si lon veut, en ce que les rapports humains
prennent la forme du rapport marchand qui les nie. Cest donc plutôt dune absence
de rapport dont il faudrait parler. A contrario, les Trobriandais
qui entrent en rapport au moyen de colliers ne sont pas esclaves de leur
médiation : ils communiquent.
Plus
généralement, on peut trouver quil donne une trop grande extension à son
concept de spectacle et lui fait perdre ainsi, dautant, de sa valeur
explicative : à tout vouloir dire, il ne signifierait plus rien. Vide de
sens donc, comme vous dites. Mais, comme dun autre côté, il le définit abondamment
et diversement tout au long de son livre, on pourrait aussi bien dire quil est
trop plein de sens ce qui ne lempêcherait aucunement dêtre une imposture,
je vous laccorde.
Bref,
Debord nest pas toujours dune grande clarté vous me direz que ce nétait
pas une lumière. Il a du mal à définir son objet avec toute la rigueur
scientifique souhaitable il tourne autour : ce que vous appelez ses
« circonlocutions » qui sont aussi une manière de le
circonscrire. Cest que cet objet nest pas un objet ordinaire : cest un
objet métaphysique, ce qui nest pas étonnant puisque la marchandise
elle-même est « pleine de subtilité métaphysique » et que le
spectacle est le spectacle de la marchandise, de la richesse, de la
communication, de la société.
Tout
cela ne vous a pas empêché de faire grand et bon usage du concept de spectacle.
Cest donc que vous laviez suffisamment compris au moins au sens
premier de ce terme. Dieu sait ou plutôt ne sait pas : il paraît
quil est mort que vous lavez assez trimbalé ce foutu
« spectacle », avant de songer à vous en débarrasser. À vous
entendre, vous aviez pourtant des doutes : longtemps vous avez
douté ; jusquà ce que vous vous décidiez enfin à lui faire la peau pour
voir ce quil avait dans le ventre ; et là stupeur : que couic !
Et pourtant ce quil pouvait peser ! Vous auriez du lexaminer au
départ ; vous vous seriez épargné bien de la peine. Mais non, vous aviez
confiance : cétait le bagage de Debord tout de même, dont vous fûtes le
compagnon de route et de beuverie. Le salaud ! Comment sy était-il pris
pour escamoter le contenu ? le bateleur de la couverture
de son dernier ouvrage serait donc un aveu posthume : il aura bien trompé
son monde ou pour donner tant de poids à un concept aussi creux ?
Mystère et boule de gomme. Quant au reproche que vous lui faites didentifier
le spectacle aux médias, il nest pas là pour être pris au sérieux Debord
prend bien soin de distinguer le spectacle « pris sous laspect
restreint des moyens de communication de masse, qui sont sa manifestation
superficielle la plus écrasante » du spectacle « compris dans
sa totalité » ; ce nest que le comparse destiné à couvrir
le premier terme de lalternative, celui qui est chargé de lexécution :
lassassin.
Il
reste que Debord qui se flattait dêtre toujours « resté dans les
limites de lexcès » il parlait de lalcool aura fini par
outrepasser les bornes ; et quand les bornes sont franchies, il ny a plus
de limite, cest bien connu je ne fais pas référence à lalcoolisme qui peut
être borné, entre autres, par la polynévrite. Celui qui se voulait exemplaire
se devait de soutenir sa (mauvaise) réputation jusquau bout ; et
il faut bien reconnaître quà sa manière il a réussi : le léopard
(salopard, salonnard etc., vous aurez complété) est mort avec ses taches. En
1972, il pouvait encore écrire à Denevert que lI.S. na découvert que « très
peu didées essentielles : deux ou trois », il est vrai quil
ajoutait aussitôt que cest « un résultat extrêmement riche »
si on le compare avec ceux qui nen ont trouvé « quune ou même pas
vraiment une ». Il ne se vantait pas encore davoir inventé « la
théorie exacte de la société »
3,
mais il nétait pas loin daffirmer péremptoirement la perfection
quasi-intangible de son livre : « Il ny a pas un mot à changer à
ce livre etc. » (1979). On se souviendra quen 1957, déjà, alors quil
se préparait à devenir situationniste, il écrivait, utilisant sans vergogne le
pluriel de majesté : « Nos ambitions sont nettement mégalomanes
[...] » ce qui était un signe. Le penseur de pointe aurait dû se méfier
de livresse des sommets (qui est aussi bien celle des profondeurs). Vous êtes
donc parfaitement justifié à fustiger comme il le mérite celui qui se
pensait au-dessus de toute critique, retranché dans lorgueilleuse forteresse
de sa théorie qui nest plus à présent quun cénotaphe livré à la canaille. Il
en est même qui poussent laudace jusquà en rapporter des morceaux choisis
chez eux ! Pauvre Debord ! la canaille intellectuelle pille son
mausolée. Avec modération pour le moment comme vous le notez la canaille se
rue, mais avec prudence (on ne sait jamais avec un suppôt du Diable qui
contrairement à Dieu qui est mort, a la réputation dêtre immortel) ; sauf
Sollers qui est un esprit fort. Mais le malheur de la canaille intellectuelle,
cest quelle ne peut semparer que dune pensée morte : elle naura dans
la bouche quun cadavre. Alors, bien évidemment, cest le sens trivial de
spectacle qui va lui plaire ; puisque aussi bien cest le seul quelle
soit en mesure de saisir (dans les deux sens courants du terme) et
quelle est entièrement au service de ce spectacle. Quant à la fine fleur de
cette canaille, selon quelle donne dans le pseudo-cynisme moderne (celui qui
aboie pour faire croire quil peut mordre) ; ou dans la critique-critique,
elle verra son importance confirmée par le grand rôle quelle joue dans ce
méchant spectacle ou elle y justifiera sa présence par le fait quelle y
apparaît bien, mais en ennemi.
Que
Nabe reprenne le terme de spectacle comme sil allait de soi ne saurait
étonner : cest un garçon qui ne doute de rien ; mais quil puisse
ainsi attester dune « société du spectacle » me paraît
douteux : il est bien trop occupé à essayer dattester sa propre existence
décrivain pour pouvoir témoigner en faveur de quoi que ce soit dautre, fut-ce
une imposture qui dailleurs na jamais eu besoin de lui pour se soutenir
et dont la démolition, à laquelle vous travaillez darrache-pied, ne pourra en
rien lui être imputé non plus si, comme vous lui en faites grief, il participe
malgré tout à cette entreprise de tromperie à son corps défendant.
Vous
reprochez également au petit Nabe de croire je vous le disais : il ne
doute de rien que le mutisme des esclaves est dû à la télévision et non le
contraire ; et cela vous est prétexte à dénier toute espèce dimportance à
linstrumentation de lesclavage (quimporte la chaîne pourvu quon ait
lesclave) qui se trouve être, cela tombe bien, celle du « spectacle »
dont vous ne voulez plus. Vous reconnaissez tout de même à la télévision, dont
le développement est « un phénomène sans importance notable »,
une vertu pédagogique : elle renseigne sur labjection des esclaves et de
leurs maîtres. Cest toujours ça. Si, comme il vous plaît de laffirmer, le
monde que vous avez bien connu en 1958 celui davant la télévision (et
davant lI.S.) et celui daujourdhui sont bien essentiellement les
mêmes, on ne peut nier dailleurs vous ne le niez pas quil y ait un
progrès (on narrête pas le progrès de laliénation) : « On est
désormais abruti dans les Charentes comme on lest au Texas. »
Ainsi ce monde est devenu visiblement, partout et pour tous
(cest le triomphe de la démocratie !) ce quau fond il a
toujours été. De lui on peut dire : il a changé ; mais il est aussi
resté le même ou bien linverse. Ce qui ne doit pas être pour vous étonner.
Mais dans ce monde « strictement immobile depuis deux siècles »,
il sest au moins passé un événement majeur : « Dieu [Balzac,
Edern-Hallier dixit] est mort »; et le monde quil avait informé
a progressé par son mauvais côté. Aujourdhui ; les marchands sont les
maîtres absolus du Temple : ils assurent eux-mêmes le service
divin. Hegel a raison à ce quil paraît. Et si Balzac était Dieu,
Hegel quant à lui est bien le Diable.
Juillet
1997
Notes
1.
Petit exercice de métaphysique amusante : si lon postule que la
communication ( le principe) existe de toute éternité, dès lors que
lon tombe (chute) dans la catégorie du temps (historique), on séloigne ipso
facto du principe (la communication). Par conséquent, toute société
(historique) ne fait que manifester sous une certaine forme cet éloignement
(aliénation) progressif et inexorable. Dans la société la plus moderne (la
nôtre, celle de la marchandise), il se manifeste sous sa forme achevée de
spectacle de la communication où la séparation est à son comble : dun
côté le réseau mondial de lactivité marchande (la communication) ; de
lautre les spectateurs branchés (les esclaves émancipés) qui assistent
en silence (passivement) à la représentation permanente de la marchandise. Non
plus ultra : à reprendre depuis le début.
2.
Ou convient-il de décliner avec vous : ce vieux pédé (voire
pédophile : il paraît quil aimait « les très jeunes filles pas
touchées par la saleté du monde ») jésuite alcoolique qui ne savait
même pas planter un clou, affligé qui plus est dune vilaine petite quéquette
en bec de théière et dun gros bide, dont les théories fumeuses étaient
publiées par un falsificateur juif qui a été bien puni lorsquil a pris quatre
balles dans la tête, ce qui a obligé le rebelle chic a baisser sa culotte
devant une raclure de bidet, et à boire avec lui jusquà la lie le verre quil
avait dabord refusé à son con de père, pour assurer la diffusion de ses
uvres, avant de se suicider au dernier stade dune polynévrite quil na dû
quà lobstination de toute sa vie divrogne ostentatoire. (À moins quil nait
été repasser lui aussi par un bon ouvrier qui savait se servir de ses
outils, mandaté par linstance spectaculaire quil menaçait impunément depuis
trop longtemps.) Lai-je bien descendu ?
3.
Le fait quune pensée nait pas deffet ne veut pas dire quelle soit
intrinsèquement fausse ; ce qui ne veut pas dire quelle soit pour autant
exacte. Une pensée qui ne vient pas en son temps na pratiquement aucun effet
de la même manière quune pensée qui a fait son temps. Cest aussi le sort
dune pensée qui nest pas reconnue vous en savez quelque chose et qui pourtant
peut être exacte. Il est possible quon la reconnaisse dans un siècle ou
plus. Il faut avoir la patience du concept.
SALUT LARTISTE !
TANT PIS SI JE ME TROMPE !
2. À propos de
la réponse à Tomás Bueno.
Vous
affirmez ne pas fonder votre argumentation sur « le concept réduit du
spectacle » qui est le seul que vous reconnaissez désormais chez
Debord. Vous prétendez quil « na jamais pu, malgré ses prétentions et
ses protestations, dépasser ce concept réduit » ce qui nest pas
étonnant puisquil ny en a aucun qui serait plus général. Pourtant vous
argumentez contre ce concept réduit promu général tout en laissant à dautres
le soin de prouver quil a un sens qui ne soit pas celui, réduit, sur lequel
vous ne fondez pas votre argumentation, mais auquel vous les renvoyez
inexorablement parce que vous nen voyez pas dautre. In girum.
Si
lon peut raisonnablement douter que le monde soit « intrinsèquement un
spectacle » ; cela nempêche pas le nôtre de se montrer effectivement
spectacliste ce qui explique que Debord y ait vu un « spectacle »
Et sil y a bien « un spectacle du monde comme il y a un spectacle de
la nature » ce nest pas celui dont parle Debord. Il fait
explicitement référence à cette seconde nature que constitue le monde de
la marchandise. Ainsi donne-t-il entre autres, il est vrai : que
na-t-il songé à ramener son concept à géométrie variable à la dimension plus
modeste dun article de dictionnaire [du Petit Larousse par exemple,
quaffectionne particulièrement Voyer] auquel on puisse facilement se reporter
la définition suivante du spectacle : une « Weltanschauung qui
est devenue effective, matériellement traduite » . Il ne lentend donc
pas non plus comme un « événement illusoire » Il le définit
comme une vision du monde qui sest objectivée. Ce qui ne veut
pas dire pour autant que ce soit une vue objective du monde. Il y une
« réalité » spectaculaire dans lexacte mesure de cette
objectivation. Il y a donc malheureusement une « réalité »
économique ; mais léconomie nest pas la réalité, la substance du
monde, comme les utilitaristes ont intérêt à le faire croire. On
ne voit pas le monde tel quil est ; il est (devenu) tel quon le voit :
vision de la misère et misère de la vision. Le monde est tout ce qui arrive
pour le meilleur ; et aussi, pour le pire. Comme chacun peut le constater de
visu.
Sil
y a malgré tout une « illusion spectaculaire » , elle réside
en ceci : que le spectateur croit communiquer (voire communier
avec) au moyen des marchandises, alors que ce sont les marchandises qui
pratiquent la communication comme vous le dites fort justement. L» illusion
spectaculaire » est cette illusion qui existe chez le
spectateur de participer (ce en quoi le spectacle est moderne) à la
communication à travers celle de la marchandise (« cest lui qui
fait tout ça et il est content ») qui, elle, est bien réelle est la
seule réelle.
Ce
« prétendu usage spectaculaire » de la marchandise est donc
plutôt un usage véritablement spectaculaire. Dans lusage spectaculaire
il y a une inversion de lusage tel quon le pratiquait chez « les
vrais hommes » . Le chef trobriandais qui fait étalage de ses ignames
fait létalage de sa puissance [en fait ce nest pas
« sa » puissance ; mais la puissance quil manifeste par son
« étalage »]. Le spectateur qui déballe sa marchandise fait étalage
de la puissance marchande : ce nest pas lui qui possède la
puissance, cest lui qui est possédé [dans tout les sens du terme]. Le monde de
la marchandise est le monde à lenvers. Plutôt que la « trace
fossile de lusage tel quon le pratiquait chez les vrais hommes » ,
lusage spectaculaire est la forme dégradée jusquà linversion
(enculés !) par la civilisation marchande de cet usage véritable.
Si
léconomie politique (economics) que vous reconnaissez finalement comme
une science (tout en la privant de son objet : « economy nest
rien » ) alors que vous semblez ne plus accorder lidéologie que
comme une concession (« si vous y tenez » ) à danciens
lecteurs qui pouvaient croire quelle était au centre de votre critique
procède du postulat utilitariste de base (« Il faut bien vivre »
) auquel elle renvoie et qui nest rien dautre quune pétition de principe
(lexistence de la science prouve celle de lobjet et laffirmation de lobjet
justifie la science), le vocable economy nest pas aussi « vide
de sens » que vous voulez bien le dire puisquil désigne, mine de rien
(la « contrebande » ), sous une apparence insignifiante, la Loi
de ce monde que tous les perroquets répètent à lenvie (quand on dit :
économie moderne, économie primitive, « économie de pêche et de
cueillette » etc. on signifie ladhésion à luniversalité de la Loi),
cette Loi daprès la colère de Dieu ou plus exactement la version moderne de
cette ancienne Loi ; qui dit : « Tu gagneras ton pain à la
sueur de ton front. » ; une Loi qui est pour lhomme déchu
lhomme de désir qui nest au fond que la créature du besoin un destin :
une fatalité ; qui lui a été imposé par Dieu après quil leût chassé du
Paradis, ce monde sans histoire où la communication règne de toute éternité,
pour être jeté dans le Temps, où elle nest plus que le moyen de satisfaire la
soif inextinguible du besoin qui ne séteindra quavec le Temps lui-même, dans
le Paradis retrouvé. Et si Dieu nest quune « superstition »
, cest une superstition fondatrice, dont la religion procède. Le mythe
fondateur peut bien être battu en brèche par quelques esprits forts et la Loi
méprisée des prévaricateurs ; une fois la religion fondée et installée dans
ses meubles et immeubles, cest à la dure réalité de lÉglise militante et de
la religion matérialisée qui na rien dune « illusion spectaculaire »
maçonnée de grossiers sophismes, en effet que lon se heurte. Avec les
résultats quon sait. Hegel disait que penser fait mal à la tête. Et pourquoi
les murs sont-ils si solides ?
Il
reste que si les marchands dominent effectivement le monde (et si leur
vision du monde domine comme Loi du monde) cest bien parce quils ont
affaire (le monde des affaires ! ) de par leur activité avec le principe,
la substance, la réalité : la communication (le divin commerce) ;
parce quils se sont fait les promoteurs du grandiose « spectacle »
de la communication aliénée dans cette seconde nature qui est désormais la seule
réalité de ce monde : la marchandise. Voilà pourquoi le commerce domine le
monde comme vous lexpliquez excellemment à M. Bueno. En passant, et puisque
vous envoyez volontiers vos adversaires se faire voir chez les Grecs,
laissez-moi vous rappeler quHermès, le messagers des dieux, est à la fois le
dieu du commerce et celui des voleurs (divin commerce !) ; et que le
Christ lui-même est représenté en patibulaire entre deux larrons (la sainte
trinité !). Et puisque nous y sommes (chez les Grecs), laissez-moi vous
dire que vous vous illusionnez en assimilant peu ou prou la démocratie
électronique du Web à une nouvelle Athènes. La fréquentation du forum
Debord [il sagissait du Debord of directors] devrait suffire à vous
désabuser : nentendez-vous pas votre voix qui résonne dans le
désert ? Comme essaye de vous le dire M. Bueno, ce nest que le dernier
salon où lon cause (il parle dun « rassemblement électronique de
crétins » : il faut inverser les termes de sa proposition puisque
la bêtise est première, lélectronique ne venant quaprès) ; le dernier
chic moderne : mas tu vu surfer sur la crête de linformation. Mais après
tout sil ne sagit que de profiter des plaisirs sans limite. de la
conversation, pourquoi se priverait-on ? Vous avez raison : on ne
sais jamais à qui lon parle.
En
ce qui concerne Debord et pour en finir puisque vous vous faites un devoir
de fustiger la bonne pensée partout où elle se donne effrontément en spectacle,
vous êtes tout à fait en droit de revendiquer la « mauvaise foi »
dont vous crédite on ne prête quaux riches M. Bon. Qui pourrait vous en
vouloir ? Que ceux qui nont jamais souffert dune crise de foi ils sont
légions aussi ceux qui ne se plongent jamais dans leau du doute vous jettent
les premières pierres. Elles vous serviront à bâtir votre église ou une
petite chapelle ; à moins que vous ne préfériez en faire une tour.
[Finalement ce fut un château dit : le Bas Château où le
« maître » officie pour une poignée de « fidèles » cest
donc aussi un oratoire.]
Bien
à vous.
LE SPECTACLE DANS
TOUS SES ÉTATS :
EN MARGE DE « LA SOCIÉTÉ
DU SPECTACLE EST TRÈS PEU SPECTACULAIRE.
Réponse à M.
Bueno. »
Le
15 mars 1998
Monsieur,
La
vengeance est un plat qui se mange froid. Évidemment. Mais manifestement vous
pensez quil gagne à être réchauffé. Comme une bonne choucroute. Cest affaire
de goût dont on ne discute pas. Les connaisseurs apprécieront. Le « spectacle »
façon Debord nest plus du vôtre : de la mauvaise cuisine. Dun autre
grand chef « situationniste » qui ne manquait pas de recettes pour
les marmites du futur vous écriviez : « On peut se demander
comment un si constant imbécile [...] a pu écrire un tel livre. »
(Il sagissait du très substantiel Critique de la raison dialectique.)
Vous ne pouviez faire preuve de la même indulgence avec celui de Debord. Lordure
capable de chier sans vergogne dans vos bottes ne pouvait être quun gâte-sauce
qui essaie de se faire passer pour un maître-queux. Le grossier personnage
méritait de rejoindre « son complice » au huitième cercle de LEnfer.
Le véritable génie culinaire dun Céline « génial parce quantisémite
et antisémite parce que génial » transfigure quant à lui tout ce quil
touche. Il suffit pour sen convaincre de goûter ses Bagatelles pour un
massacre : Delikatessen. Sollers qui est un fin gourmet ne sy est pas
trompé ; et le gastronome en culotte courte du Régal des vermines sen
lèche encore les babines. Qui a vomi a dîné. Et vous voudriez faire de la
référence à Céline la pierre de touche de la mauvaise pensée ? De la
mauvaise cuisine littéraire certainement. Ce qui nous ramène au « spectacle »
debordien, victime expiatoire de votre vindicte, auquel vous faites subir les
derniers outrages. Si dans le cas de BHL vous travaillez comme il se doit à la
hache, avec Debord cest plutôt : Massacre à la tronçonneuse.
Liquidation totale : tout doit disparaître.
Il
ny a pas plus de société du spectacle que de spectacle de la société ;
vous êtes formel. La société nest pas spectacle pour la bonne raison que si
elle était spectacle on la verrait : or elle napparaît pas. Certes la
société napparaît pas parce que la société est un résultat :
une tâche à accomplir. Quand la société apparaîtra enfin tous les
problèmes seront effectivement résolus : mais cest pas demain la
veille !. Si la « chose même » est invisible elle la dailleurs
toujours été sauf pour Hegel qui a cru la reconnaître (mais ce nétait quun
artefact induit par le système) en Grèce pourtant il y a bien quelque
chose qui se manifeste si exclusivement quon ne voit littéralement
plus rien dautre (en ce sens on pourrait dire quelle napparaît plus tant
elle est manifeste ; elle est devenue naturelle : la « chose
même » ? mais on est dedans !) : la marchandise et
son réseau de communication planétaire qui est aussi un système dorganisation
totalitaire de lapparence auquel rien néchappe. Ce que précisément Debord
fustige sous le nom de (société du) « spectacle ». Mais vous
ne voulez plus de sa société ; et vous avez soupé de son « spectacle ».
Rideau ! donc, comme dirait le Nabot.
Par
contre vous nhésitez pas à voir dans luvre de Céline la grandiose métaphore
de Popu livré au commerce. Vous trouvez même que son antisémitisme qui est une « partie
intégrante de son génie » le « protège » en outre
efficacement des « attouchements impurs ». Si tel est aussi
le but de votre anti-debordisme spectaculaire (au sens vulgaire du terme), la
méthode est impeccable. Et vous avez du même coup votre propre pierre de touche :
a-t-il craché sur lordure situationniste ? Il est des nôtres. Quoi quil
en soit, votre argumentation ne sen mord pas moins la queue excusez-moi de
vous le dire. Elle fait leffet dune série (qui na rien daléatoire) de
variations en boucle sur le thème : le « spectacle » na aucun
sens en dehors de celui de médiatique ; la preuve : cest
ainsi que tout le monde le comprend habituellement (sauf BHL et quelques
nostalgiques du Reich, mode demploi ; ainsi quune poignée de « grognards »
rescapés de la campagne de 68, restés fidèles au général Debord) ; donc
tout le reste cest peau-de-balle (ou balle-peau). Vous nous promenez ; on
se demande : est-ce quil veut nous perdre ? On cherche les cailloux ;
on essaie de sy retrouver. Vous nous dites que vous vous trompiez tout le
monde peut se tromper ; quil y avait erreur sur la marchandise. Dont
acte. Le « spectacle » nétait finalement quune auberge espagnole.
On y trouve à boire et à manger ; mais cest le client qui a tout apporté dans
son Rucksack. Que croyez-vous quil laisse quand il sen va ? Nada de nada señor Bueno.
Puisquon vous le dit et on vous le répète ça doit être vrai.
Il
nen demeure pas moins que vous aviez entrepris en dautres temps (autres
murs) une première critique moins « négationniste » (vous étiez plus
constructif ; à présent vous êtes en pleine déconstruction) du « spectacle »
à laquelle on ne peut sempêcher de trouver, lorsquon y revient, dautant plus
de consistance quelle se voit désormais systématiquement privée de tout objet.
Votre fureur iconoclaste ne laisse plus guère dautre choix à lamateur de
spectacle que labonnement à Canal +. À moins quil ne préfère, tout
compte fait, retourner à sa collection du Journal de Mickey ou à ses
albums de Tintin.
« Lenfance ?
Mais cest ici ; nous nen sommes jamais sortis. »
Bien
à vous.
Christian
Bartolucci
(Suite et) FIN du spectacle
Les
récentes communications de Voyer sur le « spectacle » témoignent de
ses efforts constants pour priver celui-ci de tout sens. Et comme on peut le
constater le résultat est plutôt brillant à défaut dêtre tout à fait
convainquant.
Ainsi
de ses dernières considérations grammaticales illustrées de nombreux exemples
sur la transitivité ou lintransitivité du « spectacle », qui veulent
établir que lorsque celui-ci prétend se passer superbement de complément (forme
intransitive) il est sans objet et quand il les admet généreusement les uns
après les autres (forme transitive) il se montre trop versatile pour fonder un concept
sur lequel on puisse vraiment compter.
Curieusement
Voyer oublie dans ses définitions successives du spectacle celui de
spectacle comme inversion de la réalité qui est précisément à la racine du
concept debordien. Ainsi lorsquon dit : le triste spectacle de
livrognerie ostentatoire, tout le monde voit de quoi il sagit ; mais
quand Debord parle de « spectacle » cest précisément à propos du
monde moderne quil présente explicitement comme un monde à lenvers ;
où il ny a pas seulement une séparation reconnue entre acteur et
spectateur comme au théâtre par exemple où chacun occupe normalement sa
place ; mais où cette séparation se double dune inversion
(enculés !) de la « réalité » : le spectateur se prend pour
un acteur alors que lactivité lui échappe totalement. Dans un cas il sagit
dune illusion qui se présente comme telle ; dans lautre dune tromperie
qui a intérêt à se faire oublier : cela fait toute la différence.
Ainsi,
Voyer nous promène. Il nous fait voir du pays et du (beau) monde. Cest
toujours enrichissant ; et de plus ça ne coûte rien. Après son passage par
lAcadémie le concept de spectacle a opportunément trouvé un sens qui nest pas
celui de médias ; mais cest celui dun Platon quelque peu « dévoyé » :
« ce qui existe réellement ne paraît pas, donc ce quon voit est une
illusion, un spectacle. » Si chez Platon lessence ne paraît pas on
a que lombre des idées
, le monde nen
existe pas moins comme manifestation de lessence. (De la même manière que chez
Hegel lessence ne se dissimule pas derrière lapparence : elle paraît
dans le phénomène.) Le monde de Platon nest une « illusion »
que parce la réalité est posée par principe dans lidée ; mais en
même temps cette « illusion » participe de lidée qui lui
imprime sa marque de fabrique : il ny a donc pas tromperie sur la
marchandise.
Ce
qui nous ramène au « spectacle » moderne. Debord en ce qui le
concerne ne soccupe nullement de « lessence » ; ce qui
lintéresse cest lapparence telle quelle se présente dans la société
marchande. Cest ainsi quil définit généralement le spectacle comme une
organisation totalitaire de lapparence à lépoque de la marchandise
triomphante.
On
peut évidemment lui reprocher, comme le fait Voyer, de ne pas apporter de
réponse au passionnant problème de « lessence » ; et
même relancer à loccasion la vieille querelle des universaux : réalisme
contre nominalisme ou se ralliera-t-on avec Abélard à un réalisme relatif
parce que si seul lobjet isolé est donné à la perception, force est dadmettre
que les relations entre les objets sont données simultanément ? Le fait
est que telle nétait pas lambition de Debord comme a pu le penser [ou faire
semblant de le penser] Voyer qui ne lui naccorde plus à présent que davoir
été un ultra-degauche marxiste « un peu moins bête que les
autres ». Mais il lui reproche quand même dêtre
« marxiste » : cest-à-dire utilitariste ; car cest
précisément là que le bât blesse pour Voyer et là donc que sa critique porte
véritablement. Or, cest à travers son concept de spectacle que Debord, qui
accepte par ailleurs sans critique lutilitarisme de Marx, échappe justement à
cet utilitarisme ; parce quil conçoit laliénation comme spectacle. Ce
qui en son temps (1971) navait pas échappé à Voyer : « La théorie
du spectacle est la première théorie qui depuis Marx se soucie dêtre une
théorie de laliénation. » Doù son intérêt pour la
« chose » (et les situationnistes qui la portait) ; et
conséquemment la critique de son insuffisance quil entreprendra courageusement
(et seul). Cest ainsi quil va être amené (par la force de la
« chose ») à pousser (dans le sens dun anti-utilitarisme radical) le
concept de spectacle (et Debord par la même occasion) dans ses derniers
retranchements. Mais contre toute attente Debord choisira de rester cantonner
dans sa retraite de situationniste paisible (où il pouvait à loisir se livrer
en sous-main à divers petits bricolages indignes de celui qui se flattait de ne
travailler jamais pour ne pas se salir les mains) ; plutôt que de
risquer (laventure était morte) une sortie et dengager un débat ouvert. La
suite est désormais connue de part le vaste monde (Wide Wild World)
et comme chacun peu le constater, les hostilités continuent.
Mais
éloignons nous momentanément du champ de bataille (plein de bruit et de fureur)
pour revenir à ce qui constitue lenjeu théorique de la « querelle du
spectacle » : Debord na pas rempli son contrat
anti-utilitariste ; il a fait semblant : cest un imposteur. Doù les
raisons de la colère. Mais dun autre côté, comme le principal intérêt du
« spectacle » réside précisément dans sa charge
anti-utilitariste, on comprend mieux lacharnement et les difficultés que Voyer
éprouve à sen débarrasser aussi complètement quil le voudrait, parce que lorsquil
pointe la tare utilitariste du spectacle debordien, il montre aussi
lanti-utilitarisme irréductible du concept honni.
Ainsi
de la proposition : « le monde de la consommation est en réalité
celui de la mise en spectacle de tous pour tous. », présenté comme un
paradigme de la fausseté. La démonstration est la suivante : dans la
société marchande les signes de distinction étant obligatoires (et identiques)
pour tous ne distinguent plus ; et par conséquent lusage de la
marchandise comme parure sociale échoue ; donc : il ne peut y avoir
une « mise en spectacle de tous pour tous. »
Mais
justement, si lusage comme parure sociale qui échoue nécessairement de
façon répétée dans la société marchande alimente par le fait même quil
échoue la soif inextinguible de consommation (qui est en réalité
soif de communication) ; cela prouve à la fois la puissance
universelle de cet usage véritable ; et contre toutes les
pseudo-justifications utilitaristes, la grande force de cohésion du « spectacle
de la marchandise » qui fait que cette « mise en spectacle de
tous pour tous » a bien lieu malgré tout (et avec succès malgré lapparence
déchec) et pourrait-on dire, envers et contre toute logique
(marchande) ; mais pour le plus grand profit du système de la marchandise.
Points de vue et images du
(pauvre) monde
« Tout
système nest quexpression, nest quimage de la raison [ou
de la déraison], nest par suite quun objet pour la raison [déraison],
qui en tant que puissance vivante se reproduisant sans cesse dans de nouveaux
êtres pensants [?], le distingue de soi et le pose en face de soi comme
un objet de la critique. Tout système qui nest pas reconnu et assimilé comme
simple moyen, limite et corrompt lesprit ; [...]. »
Feuerbach
« Debord
est bien un cinéaste, il voit des images partout. » (dixit
Voyer). Justement. Il nest pas inutile de rappeler que Debord a débuté comme
critique du cinéma (1952). Pour comprendre le concept de spectacle (dont
Voyer ne veut manifestement plus rien savoir comme il sapplique à en faire
la démonstration) il faut donc revenir au cinéma (de Debord).
Dans
Critique de la séparation (1961), on trouve la considération
suivante : « Généralement, les événements qui arrivent dans lexistence
individuelle telle quelle est organisée, ceux qui nous concernent réellement,
et exigent notre adhésion, sont précisément ceux qui ne méritent rien de plus
que de nous trouver spectateurs distants et ennuyés, indifférents. Au
contraire, la situation qui est vue à travers une transposition artistique
quelconque est assez souvent ce qui attire, ce qui mériterait que lon devint
acteur, participant. Voilà un paradoxe à renverser, à remettre sur ses
pieds. » On a ici la racine de la notion de spectacle que Debord
étendra par la suite à lensemble de la société : la séparation entre
acteur et spectateur dans un monde à lenvers ; ainsi que lindication du
sens révolutionnaire de la critique.
Au
début de son film Debord disait précisément : « La fonction du
cinéma est de présenter une fausse cohérence isolée [...] comme
remplacement dune communication et dune vie absente. » Ce qui
est exactement résumé si lon omet « isolée » la
définition du spectacle
1
qui sera développée dans son opus magnum (1967) ; quil mettra
comme il se doit lui-même en images par la suite (1973).
Que
Debord ait fini par se persuader davoir effectivement établi « avec
exactitude »
2
la théorie de la société (30 juin 1992), qui dès lors navait plus qua être
réitérée ne varietur jusquà la fin des temps (spectaculaires), témoigne
certes plus dune « perte de la saisie dialectique du réel »
3
dune hyper-lucidité de la
critique. Il nen reste pas moins, pour peu que lon considère plus modestement
la chose sous langle (cinématographique) indiqué au départ, que le spectacle
puisse être regardé comme une métaphore de la société moderne qui ne
manque pas de pertinence.
Ainsi,
que voyons nous dans la société ? Des marchandises qui séchangent
(communiquent) au moyen des hommes ; cest-à-dire un monde à lenvers où
les spectateurs, qui se croient des acteurs (parce quils participent au
spectacle), sont contraints de jouer leurs pauvres rôles (leur rôle de pauvres)
dans le grand spectacle de la marchandise qui est le véritable sujet de lhistoire.
Cela dit, une métaphore si pertinente soit-elle (ou une théorie qui prétend à
lexactitude) ne fait que rendre compte de la « réalité » dune
manière particulièrement saisissante pour lesprit ce qui nest
pas sans effet sur la masse, évidemment.
À
partir de là on sera en mesure dapprécier le spectacle debordien en toute
connaissance de cause et avec autant de (bonne) raison que Voyer
reconnaissant dans lantisémitisme de Céline « une grande métaphore de
la livraison de Popu au commerce ». Le monde de Céline est bien le
même que celui de Debord (à un « détail » près : là où Céline
dénonce nommément le complot ; chez Debord il devient innommable.)
Au fond cest toujours la même histoire. Tout est (dans la) métaphorisation
4.
Question de style et le
style cest lhomme comme chacun sait. Cest juste une image et cest une image
juste. Cest la triste « réalité ».
On
na véritablement que les images quon mérite.
« À
reprendre depuis le début. » de toute façon.
Notes
1.
Cest aussi une définition « qui nest pas celle du spectacle comme
médiatique » que je transmet à M. Bueno et à qui de droit.
2.
Ce que Voyer trouve décidément tout à fait exorbitant chez quelquun qui avait
un si petit zob.
3.
Le texte de la théorie na plus à faire la preuve de son
adéquation à la réalité (simple prétexte) qui nest plus là quà titre
dillustration (inessentielle) : miroir, sombre miroir comme tu réfléchis
bien.
4.
« [
] il ny a pas de dexpression intrinsèque et pas de
connaissance intrinsèque sans métaphore. [...] Le fait de connaître est
seulement le fait de travailler sur les métaphores les plus agrées [...]. »
« [
] les vérités sont des illusions dont on a oublié quelles le sont,
des métaphores qui on été usées et qui ont perdu leur force sensible [...]. »
Nietzsche.
CONTRIBUTION À LA
RÉSOLUTION DE LANTINOMIE DEBORD/VOYER
(quasi una fantasia)
Soit
lantinomie : Debord/Voyer ; qui sécrit également : Debord/anti-Debord ;
que lon se gardera de convertir en : anti-Voyer/Voyer, dans la mesure où
Debord na pas voulu se poser ouvertement comme anti-Voyer : il a préféré
feindre dignorer superbement lopposition ce qui devait fatalement se
retourner contre lui comme on le verra dans la suite de la démonstration.
Soit,
la loi de la polarité que Hegel exprime comme suit :
« LHomonyme,
la force, se décompose, donnant naissance à une opposition, qui se
manifeste dabord comme une différence indépendante et stable, mais une
différence qui se démontre en fait nêtre aucunement différence ;
en effet ce qui se repousse soi-même de soi-même est lHomonyme ;
et ce qui est repoussé sattire donc essentiellement, car il est le même ;
ainsi la différence instituée nétant pas différence se supprime encore une
fois. La différence se présente alors comme la différence de la chose même, ou
comme différence absolue, et cette différence de la chose, nest rien dautre
que lHomonyme qui sest repoussé soi-même de soi, et expose par là
seulement une opposition qui nest pas une opposition. »
Rapportons
cette loi non sans lui avoir appliqué la légère correction pataphysique quelle
mérite en loccurrence au couple antinomique Debord/Voyer alias
Debord/anti-Debord. Ce qui permet détablir avec certitude que la période la
plus féconde chez Voyer, qui trouve son expression achevée dans le Rapport,
coïncide bien avec la polarisation de son opposition à Debord. On vérifie aussi
la proposition qui veut que la réfutation dun système ne puisse pas venir du
dehors : « La réfutation véritable doit donner dans la force de ladversaire
et se placer dans lorbite de sa vigueur ; lattaquer en dehors de lui-même,
et lemporter là où il nest pas ne fait pas progresser la chose. » De
la même manière on comprend que Debord, dès lors quil se pense au-dessus de
toute critique et quil prétend pouvoir refuser unilatéralement le jeu
des forces polarisées où il est impliqué, quil le veuille ou non, non
seulement se condamne ipso facto à figer la théorie dans le dogme ;
mais loin de neutraliser comme il le croit lautre pôle, il contribue
bien plutôt à ce que lénergie sen décharge négativement contre lui
avec dautant plus de violence quil sobstine à ne pas lui répondre. Aussi
bien, pour rester dans cette logique de la polarisation, peut-on dire que
Debord contribue à décharger contre lui-même sa propre énergie devenue négative
et quainsi il sautodétruit. Ce que le corollaire à la loi énonce de cette
manière:
« Dans
une autre sphère, selon la loi immédiate, la vengeance sur un
ennemi est la plus haute satisfaction de lindividualité violée. Mais
cette loi selon laquelle je dois me montrer comme une essence indépendante
vis-à-vis de celui qui ne me traite pas comme tel, et dois donc le supprimer
comme essence, se convertit par le principe de lautre monde en la loi
opposée : la réintégration, de moi-même comme essence par la
suppression de lessence étrangère se convertit en auto-destruction. »
Or, si en parfait accord avec la loi Debord accomplit bien la vengeance de
Voyer en disparaissant, il ne peut plus y avoir dautre vengeance pour celui-ci
que de réaliser celle de Debord. Dura lex. Confronté à pareille
extrémité, on comprend que Voyer ait plutôt décidé de nen faire quà sa
(forte) tête et de poursuivre envers et contre toute logique sa vindicte sans
objet ce qui prouve quil est loin dêtre la moitié dun imbécile (de Paris)
et que si la théorie a du plomb dans laile, larbre de vie est toujours vert.
Doù
lon déduira, pour conclure, que les candidats à la remise en marche de la
machine théorique à double culbuteur renversé destinée à assurer notre salut
dans ce monde (ou dans lautre) auront prioritairement à rétablir le contact
entre les deux pôles antagonistes Debord/Voyer aujourdhui fâcheusement séparés ;
et pour peu quils soient en mesure dassurer la circulation énergétique en
évitant que tout ne leur pète à la gueule, comme il est à craindre dans ce
genre dopération, ils peuvent espérer résoudre lantinomie et arriver ainsi à
la réconciliation à un niveau supérieur.
Hegel
qui était un spécialiste de la chose appelait ça la dialectique.
Le 6
septembre 1998.
Christian
Bartolouchbème
LA PESTE SOIT DES MALCOMPRENANTS
JEAN-PIERRE VOYER
[« La
peste soit des malcomprenants » est la seule réponse que Voyer ait
jamais faite à lensemble des textes ici reproduits. En loccurrence, il sagit
de la réponse à : À propos de la réponse à Tomás Bueno. Cest aussi
un excellent exemple de la méthode Voyer face à un contradicteur auquel il ne sagit,
évidemment pas, de répondre sur le fond ; mais quil suffit de
récuser pour (et par) la forme.
1.
Dans le cas présent, Voyer commence par feindre de prendre à la lettre
un jeu de mots approximatif (que je naurais pas dû faire, cest vrai) : « ce
concept restreint promu général » dautant quil fallait plutôt
dire, tant quà vouloir faire un « mot » : « ce concept
général que vous avez dégradé sans autre forme de procès ». Cela lui
permet de monter sur son grand cheval et de brandir sa fameuse épée à couper
les cheveux en quatre : « Je nai jamais dit, etc. »
2.
Comme un sophiste ne répond jamais sur le fond ; mais va chercher
le vice de forme qui déconsidère ladversaire, Voyer sélectionne dans
mon texte un certain nombre de propositions, quil isole de leur contexte ;
ce qui lui permet de donner libre cours à sa verve sophistique quil voudrait
faire passer pour de la logique.
3.
Lopération terminée, ladversaire est « anéanti » dans tous les
sens du terme.
Je
ferai remarquer, encore une fois, à quel point sa méthode et ses façons
ressemblent à celles de son alter ego ; si bien quon peut légitimement
lui retourner toutes les épithètes infamantes quil réserve à « lordure
situationniste ». Dun côté comme de lautre, cest la même morgue
pseudo-aristocratique ; le même souverain mépris pour lautre que
ce soit le petit rital présomptueux qui ose remettre en question le « derniers
des Mohican » post-situ ; ou que lon ravale « au rang de linsecte »
un ancien « ami » comme le fait Debord avec Baudet il sagit de la
même attitude, de la même certitude de se situer tellement au-dessus de cette
tourbe qui prétend vouloir se hisser à la hauteur vertigineuse de leur cheville
congestionnée comme la grenouille de la fable on sait ce quil arriva.]
LA
PESTE SOIT DES
MALCOMPRENANTS
M.
BARTOLUCCI ME PRÊTE DES PROPOS ABSURDES
QUE JE
ME FAIS UN PLAISIR DE RÉFUTER.
« Vous
affirmez ne pas fonder votre argumentation sur le concept réduit de spectacle »
Je
naffirme rien de tel.
1)
je fonde mon argumentation sur des citations de Debord, et sur divers
arguments tirés de ma conception générale du monde et de la conception du monde
de divers auteurs.
2)
jaffirme que Debord a été incapable de penser un concept de spectacle
qui ne soit pas le concept réduit au sens de mass media.
3)
cela revient dailleurs à affirmer que Debord est en fait, à son corps
défendant, linventeur du concept réduit de spectacle. Avant lui, avant ses
prétentions à linvention dun concept général de spectacle, il ny avait pas
non plus de concept réduit de spectacle. Je tiens à préciser pour tous les
amateurs de logique de par le monde que cela ne signifie pas que Debord a
inventé le concept de mass media mais que cela signifie seulement quil
a fait de ce concept innocent un concept réduit.
Jai
bien dû écrire un jour « Non, je ne fonde pas mon argumentation sur le
concept réduit de spectacle. » ; mais cest seulement parce quun
mal comprenant mavait dit auparavant : « Vous fondez votre
argumentation sur le concept réduit de spectacle. » Ce à quoi javais
bien été obligé de répondre, étant donné mon affabilité coutumière : « Non,
Monsieur, je ne fonde pas mon argumentation sur le concept réduit de spectacle. »
Sur ce, survient un second mal comprenant qui mapostrophe [Quelle impudence !] :
« Vous affirmez ne pas fonder votre argumentation sur le concept
réduit de spectacle. » Cest ainsi avec les malcomprenants. La peste
soit des malcomprenants.
Comme
Tancrède de Hauteville, je me porte ici et là dans la mêlée où ma fidèle épée Mirliflore
(elle fait dix fois plus de victimes que les Cent Fleurs de Mao) taille
en pièce le mécomprenant pour la plus grande gloire de la sainte compréhension.
Mirliflore est, comme toute épée légendaire qui se respecte, en acier de
Damas. Voici déjà mille ans, les Damascènes savaient fondre lacier au creuset.
Lacier recueilli dans des creusets hémisphériques en argile dans un four à
réverbère avait une cristallisation radiale, orientée vers le centre de lhémisphère.
Une fois déroulé et écroui
* sur lenclume cet acier se composait dun
feuilletage
** dalliages de différentes duretés allant du doux au dur, cette
différence résultant de la cristallisation dans le creuset hémisphérique. Les
épées forgées avec un tel acier feuilleté unissaient les qualités de lacier
dur et de lacier doux. Elles tranchaient comme de lacier dur ; mais
elles avaient aussi la résilience propre à lacier doux. Cétait des armes
parfaites. Voici deux mille ans, les forgerons francs et plus récemment les forgerons
japonais obtenaient ce genre dacier par un autre procédé. Ils soudaient par
chaude portée au blanc soudant des barres dacier doux et dur alternativement.
Ensuite ils pliaient ces barres comme un pâtissier plie sa pâte feuilletée. Ils
forgeaient à nouveau etc... Ils obtenaient de la sorte un acier feuilleté
comparable à lacier de Damas. La seule différence étant que lacier au creuset
est une technique très moderne supérieure à celle consistant à fondre lacier
par petits lingots dans des bas fourneaux. Il ne faut pas confondre lacier de
Damas avec lacier damasquiné qui est seulement un acier orné superficiellement
par incrustation.
Ces
épées et ces sabres forgés avec des aciers feuilletés présentaient, une fois polis,
des moirures provenant de la différente teneur en carbone de portions de la
surface qui ne possédaient pas le même pouvoir réfléchissant après polissage.
On pense que les légendes rapportant les hauts faits dépées flamboyantes
proviennent de là. Telle est Mirliflore. Mon esprit est comme Mirliflore
qui comporte différentes teneurs en carbone, ce qui nest pas le cas de celui
du mal comprenant. Schmiede, mein Hammer, ein hartes Schwert !
* Forgeage à une
température inférieure à la température de recuit qui est la température où le
métal perd sa trempe. Lécrouissage confère au métal ainsi travaillé (pas
nécessairement de lacier) une dureté comparable à celle quon obtient par la
trempe.
** En fait un
maillage. Le feuilletage (corroyage) résulte de la technique appelée par
extension damas. Le seul vrai damas était lacier au creuset (damas de
cristallisation).
« Vous
argumentez contre ce concept réduit »
Non,
je nargumente pas contre ce concept réduit. Jargumente contre les prétentions
de Debord à avoir inventé un concept général. Au contraire, jaffirme à maintes
reprises mon indifférence absolue non seulement à légard de ce concept mais à
légard de la chose quil désigne. Ensuite, je conçois que lon puisse
argumenter contre la chose que désigne ce concept. Mais il ny a pas lieu dargumenter
contre le concept qui est parfaitement adéquat. Enfin, comme chacun sait, il ne
sert à rien dargumenter contre les mass media. Autant argumenter contre
la peste.
Il
ny a pas lieu dargumenter contre ce concept réduit qui est, dune part,
parfaitement légitime et, dautre part, totalement inintéressant. Pour moi, le
concept réduit de spectacle se résume au hideux lycéen couillu July ou à Mme
Ockrent au con si large qui sont beaucoup moins décoratifs que la charmante
femme de M. Lévy. Le concept réduit de spectacle au sens de mass media
est un concept parfait pour journaliste de lExcrément du J, de plus en
plus excrémentiel et de plus en plus J.
« ce concept
réduit promu général »
À
ma connaissance, personne na jamais promu ce concept réduit concept général.
Tout au contraire, comme je le disais précédemment, cest Debord qui, par ses
prétentions à la fondation dun concept général de spectacle, a dégradé linnocent
concept de mass media au rang de concept réduit. Avant la prétendue
invention par Debord dun concept général de spectacle, personne naurait pensé
à qualifier de concept réduit de spectacle le concept de mass media. (De
même personne na jamais pensé à dire à André Breton quil avait une petite
quéquette, ne serait-ce que parce que tout le monde sait très bien que Breton
avait une grosse bite.) Debord prétendait avoir trouvé un sens beaucoup plus
général au spectacle, une mystérieuse propriété de notre société à laquelle jai
vainement tenté de donner un contenu pendant de nombreuses années sans y
parvenir, ou bien quand je trouvais quelque chose, celle-ci navait rien à voir
avec un quelconque spectacle.
Selon monsieur B., je
laisserai à dautre le soin de prouver que ce concept réduit a un sens qui ne
soit pas le sens réduit
Quelle
idée saugrenue encore.
Je
répète à lusage des malcomprenants : je ne laisse pas à dautres le soin
de prouver que le concept réduit de spectacle au sens de mass media
pourrait avoir un sens plus général, ce qui est absolument sans intérêt et
absurde. Cest comme de vouloir prouver quune chaise est aussi une table.
Au
contraire, je laisse à dautres, ny étant pas parvenu moi-même, le soin de
prouver que le concept général de spectacle prétendument inventé par Debord a
un sens, ce qui est beaucoup plus intéressant.
Si
Debord a bien produit un concept de spectacle qui ne soit pas celui de mass
media, cela doit être facile de le prouver par quelque judicieuse citation.
M. B. concède que lon
peut raisonnablement (un mot dont M. B. semble ignorer le sens) douter que le
monde soit intrinsèquement un spectacle.
Cest
là faire injure à son idole Debord [Ce nest pas mon « idole », je le
répète ; mais ce fut, à nen pas douter, celle de Voyer] car celui-ci na
eu de cesse de prétendre le contraire. Quand le professeur de logique Debord
affirme que ce monde nest pas fortuitement ou superficiellement spectaculaire
mais quil est spectacliste (thèse 14) il ne se rend même pas compte quun
monde spectacliste est seulement un monde qui produit beaucoup de spectacles ;
ce qui est bien inférieur, du point de vue du spectacle, à un monde qui serait
intrinsèquement spectacle ou vision du monde. Un monde spectacliste est
superficiellement (quoique non fortuitement) spectaculaire. Il se contente de
produire beaucoup de spectacles sans que sa nature profonde soit changée pour
autant depuis le temps de Marx et de Balzac. Debord voudrait que le spectacle
soit limage (encore une image nen déplaise à M. Lévy, lécrivain abstrait) de
léconomie régnante. Or il ny a pas déconomie régnante, comment pourrait-il y
en avoir une image ? Debord sétonne que le but ne soit rien et le
développement tout. Or cest le propre de la communication. Dans la
communication, régnante ou non, aliénée ou non, le but nest rien, la
communication tout. Il serait anti-naïf et tout à fait utilitariste de supposer
que les Trobriandais prennent la haute mer dans le seul but déchanger quelques
coquillages. Dans la communication, le moyen est le but. Cest déjà le cas
aujourdhui. Alléluia.
Selon M. B. Debord
définit le spectacle comme une vision du monde qui sest objectivée. Il y
aurait une réalité spectaculaire dans lexacte mesure de cette objectivation.
En
effet, quand une vision du monde sobjective, quand la Weltanschauung de
Hitler devient effective, se traduit matériellement, cest assez spectaculaire.
Mais
selon Adam Smith lui-même (linventeur de la main invisible) ce qui caractérise
le monde marchand est quil ne résulte daucune vision du monde. Selon A. S. cest
dailleurs sa supériorité absolue sur toutes les autres sortes de monde connues
jusquà présent. Selon A. S., le monde marchand mettrait ainsi fin à toute
sorte de despotisme, sauf, évidemment, au despotisme de la main invisible, qui
selon Tocqueville est le pire à lexception de tous les autres. On reconnaît là
le genre de réponse que Leibnitz fit à Locke, à savoir que, oui, il ny avait
dans lentendement rien qui nait dabord été dans les sens, excepté lentendement
lui-même.
Ensuite,
quand bien même le monde marchand serait une vision du monde objectivée, en
quoi cela implique-t-il quil soit spectaculaire ? Lobjectivation de la
vision du monde de M. Hitler nest spectaculaire que rétrospectivement et au
sens où les Alpes sont spectaculaires. Je doute quelle lait été pour ceux qui
la subissaient. Et quand elle létait, à Nuremberg ou ailleurs, cétait au sens
de mass media. Hitler et Goebbels sont les véritables inventeurs des mass
media.
Je
suis bon prince [Monseigneur est trop bon : Monseigneur est grand prince].
Jadmets que « le monde soit une vision du monde objectivée »
peut sentendre au sens où le monde lui-même serait devenu vision du monde.
Mais cela reste à prouver. Cest ce que je dénie précisément. Selon moi le
monde est savoir mais il nest pas vision. La vision est précisément ce qui lui
manque. Le monde est un savoir mais un savoir aveugle. Le monde est savant;
mais il ne le sait pas. Le monde est savant; mais il nest pas conscient. Les
personnes sont ignorantes; mais elles sont conscientes. La main invisible nest
pas seulement invisible, elle ne voit pas. Ce qui tient lieu de vision du monde
dans le monde marchand est cette seule devise : « Si je tattrape,
je
tencule »
ce qui
est beaucoup moins élégant que le seul conseil que Leuwen père donne à son fils :
« Buvez frais, mon fils. »
Certes
le monde est conception du monde car il se conçoit tout seul, le salaud, sans
rien demander à personne. Mais il nest pas pour autant vision. Cette
conception est aveugle.
Et
quand bien même le monde serait vison du monde, en quoi cela impliquerait quil
soit spectaculaire ? Cela aussi reste à prouver.
Enfin,
tout propagande est une vision du monde objectivée pour cette simple raison quelle
se doit davoir des moyens. Et elle en a toujours. Mais elle nest quun
secteur spécialisé du monde et non le monde lui-même. Il en est ainsi avec les mass
media ; mais cette vision du monde objectivée, (cest à dire qui ne réside
plus simplement dans quelques têtes mais fait lobjet dune industrie) nen est
pas pour autant le monde lui-même. Là encore seul un secteur particulier du
monde est une vision du monde qui sest objectivée. Aujourdhui, le but de
cette propagande est de promouvoir un spectacle de lhédonisme et de persuader
les esclaves quils sont des individus comparables à Alcibiade alors quils ne
sont que des clones produits en masse. Les termes « vision du monde
objectivée » ne sont quune expression prétentieuse pour désigner la
propagande. Et depuis tous temps, la propagande fait un grand usage du
spectacle qui nest que lun de ses moyens.
Ceci
dit tout connard en patins à roulettes à lair dun connard en patin à
roulette. Il ne trompe personne. Les robots qui peuplent les bureaux et les
couloirs de Canal + ou de TF1, importantes officines de
propagande, ont lair de robots. Ils ne trompent personne. Pourquoi les films,
séries et téléfilms policiers ont-ils tant de succès ? Parce que les flics
sont les seuls à conserver un aspect humain dans tout cela. Ils connaissent
bien la misère. Ils sont en contact permanent avec elle, chaque jour, ce qui
explique le grand nombre de suicides dans leurs rangs. Ils nont pas lair de
robots. Ils peuvent avoir de la compassion ou de la pitié, et non pour de
lointains souffreteux mais pour leur prochain ce qui est exclu pour les
robots de Canal + qui ne connaissent que le Téléthon.
Selon M. B. léconomie
existerait parce que lobjectivation dune vision du monde existerait.
Admirez
la logique. Il y a une vision du monde objectivée. Donc, léconomie
existe. « Donc », que de crimes on a commis en ton nom.
M. B. concède quil y
aurait bien une illusion spectaculaire. Elle consisterait en ce que le
spectateur croit communiquer au moyen des marchandises.
Il
reste seulement à prouver en quoi cette illusion est spectaculaire. Pourquoi
spectaculaire ? Parce que M. B. ou M. Debord qualifient de spectateur
celui qui croit communiquer au moyen des marchandises ce qui est une pure
pétition de principe ?
Dailleurs,
ce prétendu spectateur ne croit pas communiquer, il veut communiquer.
Aucun doute ne lui est laissé qui lui permettrait de croire quil
communique.
Selon M. B. je
priverai economics de son objet (economy).
Or,
comme je lai déjà dit, lobjet déconomics nest pas economy
mais la communication. Comme on voit, je ne me lasse pas de le répéter et je ne
me lasserai pas.
Les
économistes croient le plus sérieusement du monde, avec M. B., quils étudient economy.
Mais ils se trompent, comme M. B. Enfin ce nest pas economy qui dit « tu
gagneras ton pain à la sueur de ton front » mais economics.
Selon M. B. economy nest pas
vide de sens mais désigne la Loi de ce monde (avec un L majuscule sil vous
plaît).
Economy est censé désigner
ce qui existe et non la loi de ce qui existe. Si quelque chose pouvait désigner
la loi de ce monde ce serait economics. Et encore ce serait une
prétention fallacieuse. De même que les lois de la physique sont les lois de la
physique et non les lois de la nature ainsi que le souligne Wittgenstein, les
lois deconomics ne peuvent être que les lois deconomics et non
les lois du monde et encore moins les lois deconomy qui nexiste pas.
Jean-Pierre
Voyer

PLAY IT AGAIN, SAM
Tout
le monde ne peut assurément se vanter de posséder le merveilleux instrument
spécialement trempé dont a été doté Voyer ; et qui lui permet aussi bien
de couper les cheveux en quatre et de tailler les oreilles en pointe que de
pourfendre le malheureux ferrailleur doccasion qui vient si légèrement
à sa rencontre.
Le
simple bon sens et la sagesse la plus élémentaire voudrait quil sarrêtât là.
Il devrait renoncer ; mais je persiste (et je signe). Quelque
chose un je ne sais quoi, un presque rien : le petit démon cornu de la
conciliation auquel jai la faiblesse de céder à moins que ce ne soit « lange
du bizarre » qui ne dédaigne pas non plus de me visiter me pousse à
argumenter, envers et contre toute la sainte logique. Ne serait-ce que pour
donner à Voyer le plaisir (forcément facile vu son terrible engin) de réfuter
mes absurdités ; et aussi parce quil est toujours enrichissant dêtre
instruit par une personne de qualité. Enfin et surtout parce que je pense que
le concept de spectacle auquel Voyer reconnaissait jadis le mérite dêtre une
théorie de laliénation est loin dêtre aussi insignifiant quil veut bien le
dire à présent ne serait-ce que parce quil a servi de catalyseur à ses propres
développements théoriques. Car nonobstant le grief qui est fait à Debord
davoir été incapable de se débarrasser de la tare utilitariste héritée de Marx
(qui lui-même lavait héritée des économistes bourgeois) cest précisément par
son concept de spectacle que Debord échappe à cet utilitarisme ce qui navait
pas échappé à Voyer : cest ainsi quil découvrit « avec
enthousiasme » les situationnistes et Debord, malheureusement, en même
temps que matière à la critique quil devait brillamment mettre en uvre par la
suite. Ainsi selon le concept, la marchandise tire son prestige du spectacle
1 (qui est lhéritier de la
religion
2
cest-à-dire du
système marchand en tant que tel : quon len retire, elle redevient un
objet banal la dite marchandise ne doit quaccessoirement son pouvoir de
fascination à la pub (ou aux médias) qui nest que linstrument inessentiel
de la propagande : la marchandise est à elle-même son propre propagandiste
via le système qui limpose universellement, à la fois comme mode de
communication et organisation totalitaire de lapparence : partout on a
affaire et on ne voit plus que la marchandise ; et on ne voit et on ne
pense plus quà travers les catégories marchandes. Cest cela que Debord
nomme : spectacle ; et dans ce spectacle le côté utilitariste
est opportunément mis entre parenthèses. Cest une grande victoire du système
de la marchandise davoir su dépassé lutilitarisme vulgaire de ses
débuts : il faut que ça serve (à quelque chose), pour sélever au niveau
suprême dun utilitarisme absolu qui na plus à se poser le problème de
lutilité puisque tout sert (à la communication marchande) même et surtout ce
qui (et quand ça) ne sert à rien.
Cela
dit, même le malcomprenant aura compris que le véritable problème de Voyer est
plutôt den finir une bonne fois pour toute (et par tous les moyens) avec le
« spectacle » quil ne veut plus considérer que comme la fâcheuse
séquelle dune époque révolue. Pourtant de voir ce pauvre spectacle ainsi malmené :
mis en pièces, ma plutôt conforté dans lidée (saugrenue ?) que, si on
lui faisait subir pareil traitement, il ne pouvait pas être foncièrement
mauvais.
Je
voudrais aussi, en passant, minscrire en faux contre laffirmation selon
laquelle Debord serait en quelque sorte mon « idole » (non : je
nai pas besoin de linjurier ; il est vrai quil na pas chié dans mes
bottes). Pas plus que Voyer lui-même. De toute façon, je peux bien le dire,
jai passé lâge des « idoles ».
Et,
comme jai le soucis dêtre aussi impartial et complet que faire se peut dans
cette ténébreuse affaire, je me dois de signaler particulièrement, sagissant
du cas Debord, le syndrome de latrabilaire récemment évoqué à son
sujet ; parce quil est susceptible déclairer son rapport aux images qui
semblent constituer précisément le nud du problème. En effet le syndrome
mélancolique est traditionnellement lié à la pratique fantasmatique. Les
« imaginationes malae » sont mentionnées de bonne heure dans
la littérature médicale parmi les « signa melancoliae », en
position si éminente que lon peut, selon lexpression du médecin padouan
Girolamo Mercuriale, qualifier la maladie atrabilaire de « vitium
corruptae imaginationis ». Lulle évoque déjà laffinité entre
mélancolie et faculté imaginative, précisant que les saturniens « a
longo accipiunt per imaginacionem, quae cum melancolia maiorem habet concordiam
quam cum alia compleccione », et lon trouve chez Albert le Grand que
les mélancoliques « multa phantasmata inveniunt » parce que la
vapeur sèche retient plus fermement les images. Mais cest encore chez Ficin et
dans le néo-platonisme florentin que la capacité propre à la bile noire de
retenir et de fixer les fantasmes est explicitement affirmée, dans le cadre
dune théorie médico-magico-philosophique. Sil est dit dans la Theologia
platonica qu» en raison de lhumeur terreuse » propre aux
mélancoliques, « leurs désirs fixent plus fermement et plus
efficacement leur imagination », chez Ficin cest le ballet obsédant
et épuisant des esprits vitaux autour du fantasme imprimé dans les spiritus
phantastici qui caractérise le déchaînement du syndrome atrabilaire. Dans
cette perspective, la mélancolie apparaît essentiellement comme un commerce
ambigu avec les fantasmes ; et cest par la double valeur démoniaco-magique
et angélico-contemplative du fantasme que sexplique la funeste propension des
mélancoliques à la fascination.
Cela
étant dit, je men veux davoir pu laisser entendre où avais-je la
tête ? que Voyer fondait son argumentation sur le « concept
réduit de spectacle » ou même quil pourrait argumenter contre une
aussi « pauvre chose » ; et aussi je nai nullement lintention
de prouver quun concept réduit soit autre chose quun concept réduit : ce
serait comme de prouver quune table est une chaise. Mais le fait est que Voyer
ne veut plus voir dans le spectacle debordien que ce concept réduit et
quil il ne se lasse pas de le faire savoir ; et quil laisse, quoi quil
en dise, à dautres le soin de montrer que le concept à un sens qui ne
soit pas le sens réduit. Ce que jessaie de faire dans la mesure de mes
faibles moyens (intellectuels) et avec les résultats que chacun pourra
apprécier.
Debord
définit effectivement le spectacle comme une vision du monde qui sest
objectivée. Quest-ce à dire ? Ceci : que la vision que lon se fait
du monde a le pouvoir de transformer le monde ; ou plus
exactement : quand une vision du monde devient la vision
(dominante), elle a les moyens de transformer le monde selon limage quelle
sen fait. Ce qui nest pas pour étonner Voyer. Mais dit-il : « quand
bien même le monde marchand serait une vision du monde objectivée, en quoi cela
implique-t-il quil soit spectaculaire ? » À cela on répondra le
plus simplement du monde : précisément parce que Debord, à la suite de
Marx qui avait déjà dévoilé le double jeu de la marchandise, analyse le monde
marchand en terme de spectacle 3
cest une « pétition de principe » si on veut : on
dirait que cest la société du spectacle (ou que léconomie nexiste
pas) : le tout est de ne pas en rester là. Bien sûr on pourra
toujours considérer que le procédé est arbitraire ; et il suffira de
récuser la définition que Debord donne de son spectacle pour trouver sa
théorie inadmissible : on ne laura pas réfuté pour autant. Et malgré sa
prétention à « lexactitude » on évitera de prendre le spectacle
pour une théorie « scientifique » ; car comme le dit le
poète : « cétait dabord un jeu, un conflit, un voyage ».
Une des propriétés du spectacle debordien que, curieusement, Voyer ne semble
pas vouloir prendre en compte, est sa capacité à « inverser le réel »
(lenculé !) : le spectacle est un monde à lenvers (chez Marx
lui-même la marchandise nest-elle pas capable de marcher sur la tête ?).
Serait-ce cette « mystérieuse propriété » que Voyer a cherché
sans la trouver ? Cest ainsi que dans la société du spectacle les
esclaves se croient des hommes libres qui peuvent communiquer à loisir avec le
vaste monde (ou encore : les habitants fortunés dune démocratie où ils
peuvent choisir librement leurs représentants et aussi bien en changer quand le
temps qui leur avait été imparti sest écoulé. Mais dira Voyer : ils ne
croient pas ; ils veulent ;et ils ne peuvent pas : ils échouent
lamentablement et à chaque fois ; pourtant ils continuent à y croire (nous
sommes bien forcés dadmettre quils continuent) parce que de toute façon ils
nont pas le choix. Tant est grande la puissance du spectacle (marchand).
Voyer
a cru bon dintroduire dans son vocabulaire la terminologie anglo-saxonne qui
distingue economics : la science économique (ce quon appelait
jadis léconomie politique) et economy : le système économique (la
« réalité » économique) ; alors que la langue française emploie
le même mot pour désigner la « chose » (qui nexiste pas) et la
théorie de la chose (qui elle existe : chacun peut la rencontrer), ce qui
pouvait fourvoyer le malcomprenant. Donc, lorsque Voyer dit que léconomie
nexiste pas cest deconomy quil sagit : il ny a pas de
« réalité » économique. Bien. Ainsi javais tort de laccuser de
priver economics de son objet puisque cet objet nexiste pas. Ce qui
nempêche pas les économistes : docteurs en rien, détudier economy ;
même sils se trompent sur la nature de lobjet qui est en réalité la
communication. Ils prennent leur vessie utilitariste pour la lanterne qui
éclaire le monde ; ce qui explique quils croient (mais ils ont intérêt à
faire croire quils croient) à la « réalité » économique du monde (ou
à la « réalité » du monde économique) parce que cest ainsi quils le
voient (et quils ont intérêt à le faire voir : pour
léconomie le rapport de lhomme aux objets doit être régi par le principe
dutilité). Mais quils croient vraiment ou quils fassent semblant
de croire (et de toute façon ils ont intérêt à faire croire)
ils ne sen occupent pas moins, à leur manière, de la « chose même »
en tant que théoriciens (mais ils ne sont en réalité que des idéologues :
ils mentent sur lessentiel) de léchange marchand (le divin commerce)
quils reconnaissent et justifient fort logiquement comme le créateur de la
richesse des nations. Pourtant si cest bien ecomomics qui dit :
« Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. », ce nest
quen tant que porteur de la « bonne parole ». Il ne faut pas oublier
quil est vital pour la prêtrise économique (et pour le dogme quelle soutient)
de se présenter et dapparaître effectivement comme un simple truchement qui
à ce titre ne fait que transmettre et transcrire la Loi inscrite de
toute éternité dans la « réalité » essentielle. Et si, à la
rigueur, il est permis, le cas échéant dinterpréter la lettre
(de la Loi), il est absolument hors de question de toucher à lesprit
(si plein de gros bon sens utilitariste). Ainsi, si economy est censé
désigner « ce qui existe et non la loi de ce qui existe », il
nen reste pas moins que ce qui existe (ou qui prétend exister) se doit
dexister selon sa propre loi (immanente) ; economy habite le
monde : economy possède (dans tous les sens du terme) son
monde ; economy est ce rien au cur dun monde sans cur qui
signifie la privation essentielle : le besoin et que lhomme est à
jamais la créature du besoin. Cest dans ce sens que jai pu dire queconomy
désigne la Loi du monde.
Mais revenons au « spectacle » dont Voyer ne
veut plus. Dans une de ses récentes communications (illustrée de nombreux
exemples doccurrence du mot spectacle tirés de son propre fond) qui témoigne
une nouvelle fois de ses efforts pour priver celui-ci de tout sens, Voyer
soumet le concept à lépreuve de la transitivité / intransitivité (quil est
plutôt dusage de réserver au verbe mais le « spectacle »
méritait un traitement de faveur doù il sort, comme on pouvait sy attendre,
dans un triste état. Ainsi est-il établi que lorsque le spectacle prétend se
passer superbement de complément, il est sans objet ; et quand il les
admet généreusement les uns après les autres, il se montre par trop versatile
pour véritablement fonder un concept sur lequel on puisse compter. On fera
remarquer que chez Debord le spectacle est de toute façon généralement
« transitif » : cest le spectacle (de la marchandise). Et ce
nest finalement quaprès son passage par lAcadémie que le spectacle
retrouve un sens qui ne soit pas celui de médias ; mais cest celui dun
Platon (qui se révèle quelque peu « dévoyé ») : « Ce qui
existe réellement ne paraît pas, donc ce quon voit est une illusion, un
spectacle. » Pourtant si chez Platon lessence ne paraît pas : on
na que lombre des idées, le monde nen existe pas moins comme manifestation
de lessence. (De la même manière que chez Hegel lessence ne se dissimule pas derrière
lapparence : elle paraît dans le phénomène.) Le monde de Platon
nest une « illusion » que parce que la réalité est posée par
principe dans lidée ; mais cette « illusion » participe
de lidée qui lui imprime sa marque de fabrique : il ny a donc pas
tromperie sur la marchandise.
Tout compte fait, et pour autant quil soit encore
question demployer le terme de spectacle, Voyer le préfère nettement
« transitif » : au moins on sait à quoi on a affaire. Ainsi du
« spectacle de lutilité » auquel il revient comme on retourne
à la terre ferme après une navigation hasardeuse à travers les brumes de
l» intransitivité » spectaculaire. « Si le spectacle est
absence de lesprit et que cette absence ne paraisse pas pour telle, ce
spectacle ne peut donc quêtre spectacle de lutile, illusion de lexistence
unique de lutile. » Précisément : quel est donc ce « spectacle
de lutile » ? Cest le spectacle de la marchandise. Il ny a pas
moyen den sortir ; alors on y revient. Dans le spectacle marchand (qui
est un monde à lenvers selon le concept honni), lutilité (« la
kermesse de lusage ») à laquelle est confronté le spectateur ne
paraît plus que comme alibi. Mais en réalité toute utilité sest abîmée
dans la marchandise au profit du seul échange. Le système de la marchandise a
libéré lobjet de tout utilité en abolissant la séparation entre l(objet
d)usage et valeur (déchange). Et la marchandise où fusionne l(absence
d)usage et la valeur nest plus une marchandise : cest une uvre dart.
La marchandise est la véritable uvre dart moderne (et luvre dart moderne
est la marchandise absolue). Aujourdhui lart est devenue inutile (tout
« lesprit » sest réfugié dans les marchandises) : la
réalisation de lart est achevée.
« Il
pleut sur les foires, quand on veut un couteau on saisit une fourchette. »
Notes :
1.
« Les objets, les marchandises sopposent à la marchandise, au
processus total de laliénation de la communication. Cest cet aspect total de
la marchandise qui dépasse et englobe chaque marchandise particulière aussi
bien que tout objet particulier que Debord distingue par le terme de
spectacle. Avec ce concept de spectacle, ce côté total de la marchandise ne
peut plus être ignoré car il est impossible de considérer une marchandise
particulière comme un spectacle sinon comme un élément dun décors où se
joue une pièce denvergure mondiale. Ce nest plus une marchandise particulière
qui peut être spectacle mais seulement la totalité de leur accumulation et de
leurs relations. »
J.-P.
Voyer, Revue de préhistoire contemporaine p.123, 1982.
2.
« Alors que la religion instaure un dualisme entre la vie réelle dans
la pauvreté et la vie fantastique dans le ciel où lhomme réalise sa richesse
dans un monde irréel, illusoire le triomphe de la marchandise instaure un
équivalent du dualisme religieux dans le monde même et non plus seulement dans
la pensée, le dualisme de la vie quotidienne qui est la vie absolument pauvre à
laquelle est condamné le pauvre moderne, et du spectacle universel de la
richesse, le spectacle universel de la communication. »
J.-P.
Voyer, Le Rapport p. 94, 1976.
3.
Qui est rappelons-le « la première théorie qui depuis Marx se soucie
dêtre une théorie de laliénation. »
J.-P.
Voyer, Reich mode demploi, 1971.
MÉRITE ET LIMITE
DU SYSTÈME DE VOYER
« Lets split, I
tell you this is it. »
Syd Barrett
1. Résumé des
épisodes précédents (pour ceux qui nauraient pas suivi depuis le début)
Longtemps
jai pensé que Jean-Pierre Voyer, qui reste malgré tout le seul
théoricien post-situationniste digne dintérêt (et donc de critique), pouvait
passer outre sa rancur danti-Debord malheureux et mener à bien
*
la critique quil avait brillamment entamée
avant dêtre expulsé du Champ Libre
**
qui se révélait ainsi nêtre quun
pré carré , poursuivie dans son excellent Rapport et dans la Revue ;
et quil va ré-exposer lors de sa tentative de rapprochement avortée avec
le Mauss. Je dois reconnaître que je me trompai : il naura fait
que tourner en rond à la recherche dune porte de sortie il brûle mais il nest
pas (encore) consumé par le feu.
Avec
la Revue va prendre fin ce que lon pourrait appeler la période
militante de Voyer. Il faudra désormais distinguer entre deux Voyer. Celui qui
sidentifie encore à un certain mouvement de contestation de la société,
qui peut correspondre avec un Denevert et ne craint pas de faire référence à « notre
parti ». Et celui qui va adopter la posture du penseur
solitaire (alors quil sait pourtant que pour avoir une idée, « il faut
être [au moins] deux ») ; qui se prépare à fulminer ses
anathèmes contre tout ce qui ose encore se prétendre révolutionnaire ;
celui qui rumine une vengeance forcément terrible contre linfâme Debord et sa
clique. Et à ce second Voyer plutôt quà lautre, allez savoir pourquoi, la
chance va sourire ; et le Destin va lui venir en aide à deux reprises. Une
première fois dabord : Lebovici, le « complice » de linfâme,
est assassiné et le Champ Libre mis en liquidation. Puis cest le tour
de linfâme lui-même, qui se suicide. Entre ces deux événements on va assister
au come-back fulgurant de notre Sturmführer, plus hégélien et
vindicatif que jamais, tout ragaillardi par larrivée dun nouvel éditeur
(anonyme, mais néanmoins providentiel : ils étaient faits pour se
rencontrer hasard objectif, Destin : kaïros !) puis
littéralement boosté par lapparition dans le cyberespace de ce qui nétait pas
encore connu comme de désormais célèbre Debordoff ; et dont il va
rapidement prendre le contrôle et devenir le Webmaster incontestable
si ce nest incontesté jusquà la mystérieuse disparition de celui-ci.
*
Mais cétait
trop demander au champion de la mauvaise pensée.
**
À linstigation
de Debord, comme plus personne ne doit lignorer à présent, qui a toujours su
comment traiter la concurrence quand elle se présentait : « [...] Guy
souhaitait trouver des égaux, mais cest lui qui devait décider qui était égal
à lui ; et dès que certaines personnes dès lorigine, dès les pré-origines,
dès lInternationale lettriste , dès que quelquun manifestait une
capacité intellectuelle ou danalyse, ou dactivité comparable à la sienne, bon
il lui laissait faire un peu et puis crac ! ; cétait... cétait une
des choses les plus ambiguës de Guy [...] » Ralph Rumney
2. Le mérite (On
na jamais que ce que lon mérite)
Le
grand mérite quil faut de toute façon reconnaître à Voyer, dans une époque déconomisme
triomphant et de marxisme suffisamment satisfait de sa (re)découverte des
écrits du jeune Marx pour se croire à la pointe du radicalisme et à labri de
tout reproche, aura été de dénoncer léconomie comme pure idéologie et,
dans le même mouvement, den appeler à une critique de léconomisme de
Marx. Mais le pavé quil lançait avec tant daplomb dans le marigot « marxo-situationniste »
du Champ Libre allait faire un flop retentissant avant de lui revenir en
pleine gueule. Voyer avait manqué son coup ; Debord ne le raterait pas.
Pourtant
ce quaffirmait Voyer, sous une forme scandaleuse : « léconomie nexiste
pas » !, nétait, à y regarder de plus près, quune salutaire
réforme de lentendement. Il sagissait, en somme, de ne plus considérer léconomie
que comme une « idéologie au sens de Marx », cest-à-dire un
mensonge sur le monde. Ce qui pourrait sénoncer simplement comme suit :
si léconomie est une idéologie, alors il ny a pas de « réalité »
économique et les catégories de léconomie ne sont pas les catégories du monde ;
ou : si les catégories de léconomie ne sont pas les catégories du monde,
alors il ny a pas de « réalité » économique ; ou encore comme lécrivait
Louis Dumont :
« Il devrait être évident quil
ny a rien qui ressemble à une économie dans la réalité extérieure, jusquau
moment où nous construisons un tel objet. Une fois ceci fait, nous pouvons
apercevoir partout en quelque mesure des aspects plus ou moins correspondants
que nous devrions en toute rigueur appeler quasi économiques ou
virtuellement économiques »
Homo
aequalis I,
1976
Exit donc la « réalité »
économique, les « faits » économiques etc., léconomie nest rien dautre
quune morale utilitariste qui prétend que la grande affaire de lhumanité
est de résoudre le problème des besoins ; et que le capitalisme prouve (de
par son existence même) quil est le meilleur système à lexclusion de tous les
autres pour ce faire. Quen somme, pour le dire avec Marx : « Il y
a eu de lhistoire, mais quil ny en a plus. »
3. La limite (Au-delà
de cette limite mon ticket nest plus valable)
Voilà
qui était bel et bon. Cest par la suite que les choses vont se gâter ;
tant il est vrai que tout ce qui nest pas dépassé pourrit. Voyer navait pas
été entendu par ceux auxquels il sadressait, ni surtout par celui qui faisait
autorité dans le petit milieu philo-situ qui tournait autour du Champ Libre
dans lespoir dy entrer : le redoutable (et redouté) Debord. Celui à qui
on avait cru pouvoir faire du tort en toute impunité allait se livrer alors à
un éreintage en règle (et sans mesure) du « grand homme » ; tout
en essayant de défendre vaille que vaille sa propre théorie dont il navait pas
réussi à assurer la publicité jusque là ; et qui, comble de malheur, était
tombée entre les mains dune petite secte dagités du bocal [tout le monde aura
reconnu lOT] qui, loin dencenser son génial créateur, le vouait aux gémonies
en le traitant descroc.
Là
où le bât blesse, cest que le bouillant Voyer, moins que jamais décidé à
concéder quoi que ce soit à ses contradicteurs, même les plus modérés ; ni,
malgré ce quil pouvait prétendre, prêt à discuter, préférant à son tour être
approuvé inconditionnellement plutôt que dentamer sérieusement ce « débat »
qui lui avait été refusé, allait semployer à obscurcir ce quil avait pourtant
déjà exposé avec une « clarté méridienne » (dixit R.
Pallais). Ainsi du désormais célèbre distinguo entre economy et economics
qui va surtout lui servir à déconsidérer ses malheureux contradicteurs qui
se verront Systématiquement reprocher de confondre les deux termes : de prendre
lun pour lautre à moins que ce ne soit le contraire ; et de ne rien
comprendre à la proposition majeure : « léconomie nexiste pas ».
Ce qui est gênant dans toute cette ténébreuse affaire cest précisément queconomy
et economics ; sont les deux faces de la même médaille qui par
conséquent sont confondues
*
ce qui nempêche pas que lon puisse aussi
les distinguer : il y a pile et face
**.
Cest parce que economics
projette ses catégories sur le monde que quelque chose comme economie
peut exister. Cest bien ce que dénonçait Marx en son temps quand il refusait
de considérer les catégories de léconomie comme des catégories universelles.
Du
coup ce qui se présentait comme une clarification charitablement proposée aux
malcomprenants, peut être tranquillement ignorée : elle ne peut servir quau
seul Voyer [dit : « le maître darme des mots menteurs »] on a
vu à quoi. Léconomie, encore une fois, ne doit être considérée que comme une
pure morale utilitariste comme celui-ci le proposait au départ destinée à
en imposer au pauvre monde. Un point cest tout.
Et
si, comme le dit pertinemment ce « sournois imbécile » de FC :
« Léconomie ne sintéresse pas à la nature du monde, [qu]elle
est strictement positiviste, [qu]elle laisse cette question aux
métaphysiciens. » ce qui nest manifestement pas le cas de Voyer qui
semble plus que jamais décidé à sattaquer au problème du monde dont il
pense apercevoir le principe dans la communication ; ce en quoi il se
trompe, même si la communication fait partie du principe, comme ne
devrait pas tarder à le montrer le bon docteur Weltfaust, sil se décide enfin
à pondre ; mais dans quel nid va-t-il déposer son bel uf ? [quon
attend toujours] ; il ne risque de toute façon pas dentrer en
concurrence avec quelque « économie » que ce soit.
De
la même façon, lanalogie quil établit entre Dieu et economy ; et economics
et religion aussi séduisante soit-elle est fallacieuse. La proposition : « la
négation de léconomie est le préalable à la critique de léconomie politique »
est fausse ; parce que la critique de léconomie politique est
identiquement négation de léconomie, cest-à-dire négation de la prétention de
léconomie politique à faire de ses catégories des catégories universelles.
Marx a critiqué léconomie tout en restant fidèle au principe utilitariste ce
en quoi il est effectivement critiquable et justement critiqué par Voyer.
Quant à la proposition parallèle qui dit que : « la négation de
Dieu est le préalable à la critique de la religion », elle est à
renverser, parce que cest la critique de la religion qui mène naturellement à
la négation de Dieu ; elle est donc fausse également. Largumentation de
Voyer est parfaitement sophistique et qui mieux quun logicien est capable de
manier le sophisme avec tant de maestria ? Tout cela nest donc finalement
quun jeu (quelque peu pervers, il est vrai).
*
Ainsi Voyer ne
peut-il pas concéder, comme il le fait du bout des lèvres, à Bueno que léconomie
(economics) est « une science, une idéologie si vous y tenez »
et dire en même temps « seul mimporte que economy nexiste pas » :
si economy nexiste pas cest parce que economics est une
idéologie, et vice versa.
**
Mais Voyer joue
à pile ou face : pile je gagne et face tu perds.
4. Ripley samuse
(Chacun samuse comme il peut)
Il
nest peut-être pas inintéressant, pour terminer, de rappeler que dans le roman
de Patricia Highsmith qui en anglais sappelle Ripleys game (et dont
Wim Wenders a tiré un film qui sappelle LAmi américain) Ripley est un
personnage quelque peu borderline, un cynique revenu de tout qui ne se
bat plus que pour sa propre cause, quelquun qui ne recule devant aucune
manipulation, surtout quand son amour-propre ou plutôt son lorgueil est
blessé, pour arriver à ses fins.
À
la fin du roman, quand la femme du pion dont il sest servi simple support
inessentiel et quil a sacrifié sans vergogne, le croise et lui crache au
visage, il aura cette réflexion : « En fait, ce crachat était une
sorte de gage, déplaisant certes, mais rassurant en même temps. » ;
parce que pour lui ce geste est la confirmation quelle aussi était finalement
rentrée dans son jeu et qu» À cet égard, elle rejoignait les
rangs de la majorité des humains. » Triste humanité !
Mais
ce nest quun roman : toute ressemblance avec un personnage existant ou
ayant existé ne serait que pure coïncidence, évidemment.
Je
voudrais, avant de prendre congé, profiter de cette intervention pour saluer le
sous-commandant Bueno pour son courage ; le Docteur Weltfaust pour son opération
de salubrité publique ; et, last but not least, notre « maître »
à tous (cette clause de style ne sadresse, bien sûr, quà ceux qui se
sentiraient concernés) jai nommé Jean-Pierre Voyer himself, pour tout
ce que nous lui devons. Nul doute quil saura encore étonner son petit monde
à défaut de résoudre lénigme du grand.
Javais
posté un petit nombre de messages sur le défunt Debordoff sous le nom de
Christian Bartolucci (dont un signé Bartolouchbème) ; celui-ci sera
dorénavant remplacé par son hétéronyme : Xavier Lucarno.
Pour
solde de tout compte.
X. L.
PUBLICITÉ DANS LA CITÉ
« Rendre
la honte plus honteuse
en
la livrant à la publicité »
Partie 1
Historique
(rapide, mais nécessaire ; je madresse à un large public) Voyer, retour
de Suisse où il a lu Marx dans son taxi (cest là quil a eu son
« illumination » ; léconomie nexiste pas) ; et lIS,
rentre à Paris où il traîne dans le « quartier » que fréquente les
situs et donc Debord. Rencontre du « chef» situationniste. Beuveries,
coucheries etc. Mai 68. Voyer, qui est un garçon plein de ressource,
« intéresse » Debord dont il devient le factotum. Il
« découvre » pour son « patron » un dénommé Gérard
Lebovici, riche agent des stars les plus en vue du cinéma français et
producteur de films à succès. Malheureusement pour notre héros, entre le
« prince Lebo » et le « pape situ » ça colle tellement bien
quils nont plus besoin du truchement ; ils le foutent tout simplement (et
« élégamment ») à la porte. Voyer, furieux, na quune idée en
tête ; se venger. Dans un premier temps, il pense à créer une 3ème
Internationale situationniste, pour remplacer celle que Debord a liquidé (cest
je sujet du bouquin de Tenret) ; nous sommes en 1983. Cest un flop magistral.
Mais la vengeance est plat qui se mange froid et que Voyer apprécie aussi
quand il est bien faisandé. Il saura attendre son heure. Le Destin va venir à
son secours une première fois ; Lebo est assassiné ; Debord est
« inconsolable ». Voyer est fou de joie et il le fait savoir ;
par Libération interposé, entre autres. Les hostilités vont continuer.
Le Destin, qui nest pas chien avec les rats, va laider une seconde
fois ; Debord met fin à ses jour. Voyer est re-fou de joie et il ne se
prive pas de la laisser éclater.
Entre
ces deux événements majeurs, Voyer a rencontré celui qui allait devenir son
(deuxième) éditeur (juif), le célèbre Karl von Nichts. Celui-ci nen revient
pas davoir été « reconnu » par le « maître » ; il va
désormais lui consacrer tout son temps libre ; sa vie. Il va ressaisir
tous les ouvrages du « maître » ; les faire réimprimer (je tiens
à faire remarquer au public, que cest moi qui lui ai suggéré dajouter le
masque et la plume au pastiche de la couverture Gallimard) ; en
assurer la distribution et tout ça gratuitement ; gratis pro deo .
Je ne résiste pas au plaisir de narrer à nouveau lhistoire de ses démêlés avec
lOT. Les méchants OTistes en voulaient dur au « maître » ; et
le valet ne pouvait que prendre fait et cause pour celui-ci. Mais sa maladresse
allait lui jouer un mauvais tour ; une erreur de manipulation dans lenvoi
dun message et voilà quil révélai, pour ainsi dire, son adresse à lennemi.
Le preux combattant électronique en fit dans son froc et changea promptement
dadresse (et de pantalon, je suppose) sur les conseils avisés du
« maître ». La suite est connu. Voyer est devenu un renégat ;
pour finir par se convertir au nihilisme islamiste. Triste FIN dun théoricien.
Et FIN du premier épisode.
(À suivre)

FIN DE VOYER
« Rendre la honte plus honteuse
en la livrant à la publicité »
Partie 2
Après
avoir fait un rapide historique à lusage des jeunes générations de la
carrière fulgurante de lOberdada Hegelsturmführer alias Voyer, devenu
depuis le Vieux-du-Bas-Château ; nous allons passer à la
« déconstruction » proprement dite de limposture voyériste. Jai
indiqué à Boris pourquoi je ne mintéressai pas à lIntroduction à la
science de la publicité : ce nest quune grossière compilation de
morceaux choisis. Je mattaquerai donc, dentrée de jeu, à la proposition
majeure : « léconomie nexiste pas », dont, selon la
légende Voyer aurait eu la révélation en Suisse où il était réfugié politique,
alors quil lisait Le Capital dans son taxi, entre deux courses. « Léconomie
nexiste pas. », est la forme radicale de la proposition qui se
décline aussi radicalement en : « il ny a pas de réalité
économique » ; mais sa formulation canonique est la
suivante : « Léconomie nest quune idéologie au sens de Marx. »
Il convient donc détablir le sens de celle-ci ; sur la quelle repose tout
lédifice (fallacieux) de la pensée du « maître ». Jai déjà fait
remarquer que sous ces trois formulations, il ne sagit que dune seule et même
proposition qui affirme de façon péremptoire que léconomie nest rien
dautre quune « idéologie au sens de Marx » ;
proposition que je gloserai comme suit : si léconomie est une idéologie
(au sens de Marx) ; alors il ny pas de réalité économique et inversément.
Que
léconomie soit une « idéologie », Voyer nest ni le seul, ni le
premier à le dire. En 1976, paraissait un livre intitulé : Homo
aequalis I, Genèse et épanouissement de lidéologie économique,
Bibliothèques des sciences humaines, Gallimard.
Je
vais en donner quelques citations :
p.
32 : « Dans sa monumentale Histoire de lanalyse économique, Schumpeter
ne donne pas de définition [de léconomique] ; il définit l
analyse économique mais il admet comme donnés demblée ce quil appelle
phénomènes économiques (1954). »
Parlant
des deux tendances qui existent chez les anthropologues qui considèrent que
dans toute société il y a « un aspect économique », il
écrit :
« La
tendance "formaliste" définit léconomique par son concept et prétend
appliquer aux sociétés non modernes ses propres conceptions des usages
alternatifs des ressources rares, de la maximalisation des gains, etc. La
tendance "substantive" proteste quun telle attitude détruit ce qui
est réellement léconomie comme donnée objective universelle, soit en gros les
manières et les moyens de la subsistance des hommes. Situation exemplaire,
puisque le divorce entre le concept et la chose démontre à lévidence
linapplicabilité du point de vue ; ce qui a un sens dans le monde moderne
nen a pas là. »
Dans
Mérite et Limite du Système de Voyer, je citai déjà la phrase
suivante :
p.
33 : « Il devrait être évident quil ny a rien qui ressemble à
une économie dans la réalité extérieure, jusquau moment où nous construisons
un tel objet. Une fois ceci fait, nous pouvons apercevoir partout en quelque
mesure des aspects plus ou moins correspondants que nous devrions en toute
rigueur appeler quasi économiques ou virtuellement économiques. »
ne dirait-on pas du Voyer pur jus ?
On
voit que le seul apport de Voyer, est davoir radicalisé ce point de
vue. Il affirme quant à lui : « Léconomie nest quune idéologie
au sens de Marx. » (cest moi qui souligne). Et, ce nest pas de chance,
il se trompe. Léconomie est bien une idéologie, au sens courant du
terme : un système didée ; ce nest pas « un mensonge sur le
monde », un idéologie au sens de Marx, comme laffirme Voyer.
Léconomie politique est lidéologie (historiquement produite) de la
bourgeoisie qui simpose comme classe dominante et cest aussi une science.
Cette idéologie traduit la vision utilitariste du monde, de la bourgeoisie.
Lutilitarisme bourgeois postule que la grande affaire de lhumanité est le
problème des besoins et quévidemment, cest elle qui est le mieux à même de
le régler grâce à sa « science ». Là où il y a effectivement un
« mensonge », cest quand elle prétend exporter des catégories
historiquement datées en les universalisant.
En
ce qui concerne la critique de Marx. Celui-ci ne sest nullement mépris sur
léconomie ; il ne pouvait pas la considérer comme « une idéologie
au sens de Marx », parce que ce nest en aucun cas une idéologie en ce
sens-là. Marx a fait une critique de léconomie politique en toute connaissance
de cause. Il écrit, dans lavant-propos de la deuxième partie de sa Critique
de léconomie politique (1844) : « Nous sommes partis des
prémisses de léconomie politique. Nous avons admis son langage et ses lois.
[
] En partant de léconomie politique elle-même, en parlant son propre langage,
nous avons montré que louvrier est ravalé au rang de marchandise, et de la
marchandise la plus misérable, [
] ».
Et
maintenant, je pose la question : que reste-il de la
« critique » de limposteur Voyer ?
(À
suivre)
IL FAUT LAISSER LES MORTS
ENTERRER LES MORTS
« Rendre la honte plus honteuse
en la livrant à la publicité »
Partie 3
Après
avoir rendu raison de la proposition majeure : « léconomie
nexiste pas », passons à présent, si vous le voulez bien, au second
titre de gloire dont se targue Voyer. Le lecteur bénévole qui aura pris
connaissance de lhistorique des événements, qui est donné dans la première
partie de cette étude, naura pas oublié comment le pro-situ Voyer a été jeté
sans ménagement dehors du Champ Libre par le tandem Lebo-Debord
(dit : cul et chemise). Pourtant, en fidèle serviteur, Voyer vient
dapporter à son maître ingrat (double) la tête du roi Lebo sur un plateau
(dargent). Mais un Voyer (même sil nest pas dArgenson) nest pas homme à
laisser un tel affront impuni. Sa vengeance de grand enfant bafoué sera à la
mesure du camouflet quil vient dessuyer : terrible.
Yves Tenret a brillamment relaté dans son livre Comment
jai tué la troisième Internationale situationniste la déconfiture que fut
la tentative du debordien évincé de monter sa propre organisation, en
1983 : je ny reviendrai pas. Il ne lui restai plus, alors, que la
solution radicale (et finale) : anéantir (théoriquement) « lordure
situationniste ». Et pour ce faire, il fallait sattaquer au
« spectacle » qui faisait la fierté de son promoteur ; et y
mettre fin par tous les moyens.
Une
parenthèse, ici, pour signaler, si tant est que cela fût passé inaperçu, la
propension de Voyer à étaler sa « science » ; cest-à-dire à
noyer (Jean - Luc !) son argumentation de références scientifique,
mathématiques etc. précises : ce nest rien dautre quun moyen facile et ostentatoire
dépater son public de lesbroufe qui ne pourra que sincliner face à une
si forte tête. Fin de la parenthèse.
Voyer
décide donc de sattaquer au « spectacle » quil trouvait naguère
tout à fait à son goût. Il faut maintenant quil soit très mauvais. Il prétend,
sans se démonter, quil avait des doutes depuis longtemps quant à lexcellence
du fameux concept : ce « spectacle » omniprésent et tout
puissant ne lui paraissait pas très catholique. Il ne voit plus, à présent, que
les contradictions de La Société du spectacle. Bref, il subodore que le
grand uvre de maître Debord ne serait quune vilaine imposture : le
« spectacle », débarrassé de tous ses oripeaux, ne serait rien
dautre que la pub et les médias (qui mentent) : bref, la classique
propagande. Il nétait pas difficile à un maître sophiste de la trempe (acier
de Damas) de Voyer de discréditer pour cause dabsence de rigueur
(rédhibitoire) lopus magnum du grand théoricien situ la mauvaise foi
aidant. Mais le malheur est quil narrivait à convaincre que les
convaincus : ses « fidèles ». Jusquau jour où le Destin encore,
qui a lair de lavoir à la bonne, lui apporte sur un lutrin la traduction
française dun livre de Gûnther Anders dont il appert que Debord sest
généreusement servi pour rédiger le sien. Ainsi lintransigeant Debord, celui
qui ne va « chercher personne », nest quun vulgaire
plagiaire, honteux de surcroît ; un « atrabilaire » qui
ne supporte pas quon puisse douter quil ne soit pas le seul et unique
inventeur de ce formidable concept de « spectacle » que le monde
entier lui envie. Tout cela était bel et bon ; et permettait au vindicatif
Voyer de porter lestocade finale croyait-il. La seule chose quil semblait
oublier lui qui savait pourtant tout cela par cur , aveuglé quil
était dans sa jubilation de voir enfin la vendetta se concrétiser, cest
que La Société du spectacle dans sa totalité qui est un plagiat ;
puisquil nest composé, en grande partie, que de fragments empruntés (sans
leur autorisation) à différents auteurs : cest ce quen situ-langue on
appelle un « détournement » celui dAnders nest pas plus
scandaleux que les autres ; Debord était un familier de la chose (son
inventeur même) depuis le début de sa carrière jusquà la fin, où il réalise
les contestés (mais incontestables) « grands détournement » de Gallimard
et de Canal + : le bouquet final. Je ninsisterai pas sur le fait
que pour nimporte quel lecteur de bonne foi La Société du spectacle
reste aujourdhui un livre tout à fait lisible et qui plus est dune
actualité brûlante. Il faut être un « fanatique » voyériste
particulièrement borné (comme son éditeur) pour se persuader du contraire. Cela
dit, rien nempêche de séparer le personnage que sest forgé Debord (et surtout
celui quil est devenu sur le tard) de son livre. Que sa pauvre tête
dalcoolique chronique ait gonflé au point quil se soit persuadé de la
quasi-perfection de son ouvrage où il ny aurait « pas un mot à
changer » ; quil ne se soit plus entouré que dune petite cour
dadmirateurs confits en dévotion (ça ne vous rappelle rien ?) quil
nhésite pas à sacrifier au gré des fluctuations de son humeur (noire)
changeante, ne grandit certes pas le personnage ; mais ne doit pas
empêcher de reconnaître la valeur de son livre et daccorder toute lattention
quelle mérite à lIS dont il fut à la fois le créateur et le liquidateur.
Pour en revenir à son « fils spirituel » (qui a
cessé depuis de lêtre), je ferai remarquer quil y a de nombreuse similitudes
entre le maître et le disciple dailleurs on peut retourner pratiquement tous
les griefs que fait Voyer à Debord dans lautre sens. Cest sans doute la
principale raison qui fait quils ne pouvaient pas sentendre bien
longtemps : avoir toujours en face de soi quelquun qui vous renvoie votre
propre image est insupportable. Si Voyer avait pu prendre la place de Debord,
il aurait agit, à nen pas douter, de la même manière ; dailleurs dans
son rôle danti-Debord qui na pas réussi, il ne se débrouille pas trop
mal ; on peut même dire quil a dépassé son modèle ; et réussit à
être encore plus méprisable que le vieux Debord ne létait devenu.
FIN
de Voyer
Fin
du voyérisme et FIN de mes interventions sur ce forum où je ne paraîtrai plus
(sauf cas de force majeure, bien entendu).
Incipit
vita nova.
Christian
Bartolucci, Xavier Lucarno et Nemo vous saluent bien.
